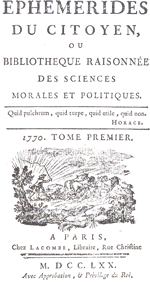
| Premiere Partie. |
| Pieces détachées. |
| N°. Premier. |
| SUITE & fin des Réflexions sur la Formation & la Distribution |
| 114 | |
| des Richesses, dont le commencement se trouve dans les Volumes précédents. | |
| §. L X X I I I. | |
| Fausses idées sur le prêt à intérêt. | |
| 115 | |
| gner par son travail. Mais tous ces motifs qui déterminent l’emprunteur sont fort indifférents au prêteur. Celui-ci n’est occupé que de deux choses, de l’intérêt qu’il recevra & de la sureté de son capital. Il ne s’inquiete pas plus de l’usage qu’en fera l’emprunteur qu’un marchand ne s’embarrasse de l’usage que fera l’acheteur des denrées qu’il lui vend. | |
§. L X X I V. |
|
| Vrai fondement de l’intérêt de l’argent. | |
| On peut donc louer son argent aussi légitimement qu’on peut le vendre ; & le possesseur de l’argent peut faire l’un & l’autre, non seulement parceque l’argent est l’équivalent d’un revenu & un moyen de se procurer un revenu, non seulement parceque le prêteur perd pendant le tems du prêt le revenu qu’il auroit pu se procurer, non seulement parcequ’il risque son capital, non | |
| 116 | |
| seulement parceque l’emprunteur peut l’employer à des acquisitions avantageuses ou dans des entreprises dont il tirera de gros profits: le propriétaire d’argent peut légitimement en tirer l’intérêt, par un principe plus général & plus décisif. Quand rien de tout cela n’auroit lieu, il n’en seroit pas moins en droit d’exiger l’intérêt du prêt, par la seule raison que son argent est à lui. Puisqu’il est à lui, il est libre de le garder; rien ne lui fait un devoir de prêter : si donc il prête, il peut mettre à son prêt telle condition qu’il veut. Il ne fait en cela aucun tort à l’emprunteur, puisque celui-ci se soumet à la condition, & n’a aucune espece de droit à la somme prêtée. Le profit qu’on peut se procurer avec de l’argent est sans doute un des motifs les plus fréquens qui déterminent l’em-prunteur à emprunter moyennant un intérêt ; c’est une des sources de la facilité qu’il trouve à payer cet intérêt, | |
| 117 | |
| mais ce n’est point du tout ce qui donne droit au prêteur de l’exiger ; il suffit pour cela que son argent soit à lui, & ce droit est inséparable de la propriété. Celui qui achete du pain a pour motif de se nourrir ; mais le droit qu’a le Boulanger d’en exiger un prix est très indépendant de cet usage du pain : c’est le même droit qu’il auroit de lui vendre des pierres ; droit fondé uniquement sur ce que, le pain étant à lui, personne n’a droit de l’obliger à le donner pour rien. | |
| §. L X X V. | |
| Le taux de l’intérêt ne doit être fixé que, comme celui de toutes les marchandises, par le seul cours du commerce. | |
| J’ai déja dit que le prix de l’argent prêté se régloit, comme celui de toutes les autres marchandises, par la balance de l’offre à la demande : ainsi, quand il y a beaucoup d’emprunteurs qui ont | |
| 118 | |
| besoin d’argent, l’intérêt de l’argent devient plus haut ; quand il y a beaucoup de possesseurs d’argent qui en offrent à prêter, l’intérêt baisse. C’est donc encore une erreur de croire que l’intérêt de l’argent dans le commerce doive être fixé par les loix des Princes. C’est un prix courant, fixé comme celui de toutes les autres marchandises. Ce prix est un peu différent, suivant le plus ou moins de sûreté qu’a le prêteur de ne pas perdre son capital ; mais, à sûreté égale, il doit hausser ou baisser à raison de l’abondance & du besoin ; & la loi ne doit pas plus fixer le taux de l’intérêt de l’argent qu’elle ne doit taxer toutes les autres marchandises qui ont cours dans le commerce. | |
| 119 | |
| §. L X X V I. | |
| L’argent a dans le commerce deux évaluations distinctes : l’une exprime la quantité d’argent qu’on donne pour se procurer les différentes especes de denrées ; l’autre exprime le rapport d’une somme d’argent à l’intérêt qu’elle procure suivant le cours du commerce. | |
| Il paroît, par ce développement de la maniere dont l’argent se vend ou se loue moyennant un intérêt annuel, qu’il y a deux manieres d’évaluer l’argent dans le commerce. Dans les achats & les ventes, un certain poids d’argent représente une certaine quantité de valeurs ou de marchandises de chaque espece : par exemple, une once d’argent équivaut à une certaine quantité de bled, ou à un certain nombre de journées d’homme. Dans le prêt & dans le commerce d’argent, un capital est l’équivalent d’une rente égale à une por- | |
| 120 | |
| tion déterminée de ce capital ; & réciproquement une rente annuelle représente un capital, égal au montant de cette rente répété un certain nombre de fois, suivant que l’intérêt est à un denier plus ou moins haut. | |
| §. LXXVII. | |
| Ces deux évaluations sont indépendantes l’une de l’autre, & sont réglées par des principes tout differens. | |
| Ces deux différentes appréciations ont beaucoup moins de rapport & dépendent beaucoup moins l’une de l’autre qu’on ne seroit tenté de le croire au premier coup d’œil. L’argent pourroit être très commnn dans le commerce ordinaire, y avoir très peu de valeur, répondre à une très petit quantité de denrées, & l’intérêt de l’argent pourroit être en même tems très haut. | |
| Je suppose qu’y ayant un million d’onces d’argent qui roule actuellement | |
| 121 | |
| dans le commerce, une once d’argent se donne au marché pour une mesure de bled. Je suppose qu’il survienne, de quelque maniere que ce soit, dans l’Etat un second million d’onces d’argent, & que cette augmentation soit distribuée dans toutes les bourses suivant la même proportion que le premier million, en sorte que celui qui avoit précédemment deux onces d’argent en ait maintenant quatre. L’argent, considéré comme masse de métal, diminuera certainement de prix, ou, ce qui est la même chose, les denrées seront payèes plus cher ; & il faudra, pour avoir la mesure de bled qu’on avoit avec une once d’argent, donner beaucoup plus d’argent, & peut-être deux onces au lieu d’une. Mais il ne s’ensuivra nullement de-là que l’intérêt de l’argent baisse, si tout cet argent est porté au marché & employé aux dépenses courantes de ceux qui le possedent, comme | |
| 122 | |
| l’étoit, par la supposition, le premier million d’onces d’argent ; car l’intérêt de l’argent ne baisse qu’autant qu’il y a plus d’argent à prêter, à proportion du besoin des emprunteurs, qu’il n’y en avoit auparavant. Or, l’argent qu’on porte au marché n’est point à prêter; c’est l’argent mis en réserve, ce sont les capitaux accumulés qu’on prête ; & bien loin que l’augmentation de l’argent au marché, ou l’abaissement de son prix vis-à-vis des denrées dans le commerce ordinaire, entraîne infailliblement, & par une liaison immédiate, l’abaissement de l’intérêt de l’argent, il peut arriver au contraire que la cause même qui augmente la quantité de l’argent au marché, & qui augmente le prix des autres denrées en baissant le prix de l’argent, soit précisément celle qui augmente le loyer de l’argent, ou le taux de l’intérêt. | |
| En effet, je suppose pour un mo- | |
| 123 | |
| ment que tous les riches d’une nation, au lieu d’épargner sur leurs revenus ou sur leurs profits annuels, en dépensent la totalité (4) que ; non contents de dé- | |
| (4) Nous demandons
à l'Auteur la permission d'ajouter à ce Paragraphe quelques Observations
qui nous paroissent importantes ; qui ne contredisent point sa Doctrine mais
qui peuvent empêcher les Lecteurs superficiels de se méprendre
sur le sens de quelques-unes de ses expressions. En général, c'est beaucoup moins par l'épargne sur la dépense des revenus, que par le bon emploi de cette dépense que l'on parvient à la formation des capitaux. L'Auteur distingue dans la phrase suivante, avec très grande raison, une maniere profitable de dépenser & une maniere de dépenser folle. On pourroit étendre cette division: appeler dépense folle la dépense extraordinaire qui consumeroit des capitaux sans nécessité ; dépense stérile, la dépense de consommation journaliere, qui ne diminueroit ni n'accroitroit la somme des capitaux : dépense conservatrice, celle qui se feroit pour les travaux qui ne produisent point de richesses, mais qui les approprient à des usages durables, moyennant lesquels on peut jouir à la |
|
| 124 | |
| penser tout leur revenu, ils dépensent leur capital ; qu’un homme qui a cent | |
| fois, & pendant un assez long espace de tems du fruit du travail & des
récoltes de plusieurs années ; telles sont les dépenses
en construction de maisons, en fabrication de machines, de meubles, &c.&
enfin, dépense productive, celle qui paye les travaux par lesquels
on accroit réellement la masse des productions que l'on consomme pour
les besoins journaliers, & celle des matieres premieres dont on peut, au
moyen des dépenses conservatrices, faire des richesses de jouissance
durable. Ceci posé, nous croyons évident que le meilleur moyen pour accroître les capitaux, est la dépense productive, & après elle, la dépense conservatrice. Mais l'épargne n'est pas productive ; elle n'est même en général que très imparfaitement conservatrice. Elle peut être destructive & nuisible lorsqu'elle se fait sur les dépenses qui auroient été productives, ou seulement profitables. Il faut donc écarter la simple idée d'épargne dans les Eléments de la Formation des capitaux. Dès le premier état de l'homme qui vit de productions spontanées, ce n'est pas l'épargne de ces productions qui le conduit à améliorer sa situation |
|
| 125 | |
| mille francs en argent, au lieu de les employer d’une maniere profitable ou | |
| et à se former un capital plus ou
moins grand. Lorsqu'il a trouvé de quoi diner, ce seroit en vain qu'il
jeuneroit par épargne ; si, d'ailleurs, il demeuroit oisif, il risqueroit
fort de jeuner toujours par nécessité. Le moyen naturel d'acquérir,
de profiter, d'amasser, de s'enrichir est le travail ; premierement de la recherche,
puis de la conservation, & enfin de la culture. Mais pour travailler, il faut d'abord que le travailleur subsiste. Il ne peut subsister que par la consommation des productions de la terre ou des eaux ; cette consommation est une dépense. Il faut aussi, pour travailler avec succès, qu'il ait des instruments ; soit qu'il employe son tems à fabriquer lui-même ces instruments, soit qu'il les acquiere, par le moyen de l'échange, de ceux qui les auroient fabriqués, & qui ont consommé en fabriquant. Les choses qu'il donne en échange, ou les consommations qu'il est obligé de faire, sont encore une dépense. Ce n'est donc que par des dépenses. faites avec intelligence & à profit, & non pas par des épargnes, que l'on peut augmenter sa fortune dans le commencement des sociétés, & avant que |
|
| 126 | |
| de les prêter, les consume en détail en folles dépenses : il est visible que, d’un | |
| les arts multipliés & perfectionnés,
& l'introduction de l'argent dans le commerce, aient étendu et compliqué
la circulation des richesses & des travaux. Mais, dans la société toute formée, l'épargne a des effets plus dangereux encore. Dès que les travaux se sont partagés au point que chacun se trouve naturellement fixé à un seul genre d'entreprise, qu'un Cultivateur ne fait que du bled, tandis que l'autre ne fait que du Vin ; qu'un Manufacturier ne fabrique que des étoffes de laine, lorsque son voisin ne se livre qu'à la préparation, des cuirs, &c. Que tout Entrepreneur en chef, soit de culture, soit de purs ouvrages de main, se charge de fournir la société d'un seul article dans la masse des consommations, & se soumet à acheter lui-même tout le reste de ce qui pourra être utile ou nécessaire à sa consommation personnelle, ou à celle de ses agents. Il faut pour completter la distribution des richesses, des subsistances & des jouissances entre tous les membres de la société, que tout ce qui se cultive ou se fabrique soit vendu & acheté ; excepté dans chaque |
|
| 127 | |
| côté, il y aura plus d’argent employé aux achats courans, à la satisfaction | |
| espece, la quantité que chaque Entreprenneur a pu se réserver
directement. Il y a même plusieurs genres de travaux précieux,
où l'Entreprenneur ne garde rien du tout de ce qu'il a
fait naître, vend tout le fruit de son travail & de ses avances, se
prive de la consommation des objets de son labeur, & rachete d'autres objets
du même genre à des qualités inférieures, pour faire
des consommations moins couteuses. C'est ainsi que les Cultivateurs du vin de Chambertin le vendent tout jusqu'à la derniere bouteille, &
se pourvoient dans le Pays d'autre vin plus commun pour leur boisson. C'est
ainsi qu'un bijoutier ne gardera pour lui aucun des diamans qu'il taille ou
qu'il monte, & qu'il les vendra tous pour faire subsister & pour enrichir
sa famille. C'est ainsi qu'un Fabriquant ou qu'un Marchand d'étoffes
de soie, ne sera cependant habillé que de laine, &c. Mais pour que tout ce qui se cultive et se fabrique puisse être vendu, il faut que tous ceux qui reçoivent de la nature & de leur travail, des revenus, & des reprises ou des salaires, qui sont les uniques moyens d'acheter mettent ces moyens |
|
| 128 | |
| des besoins ou des fantaisies de chaque particulier, & que par conséquent il | |
| d'acheter en circulation. Car, en vain, la moitié de la Société
mettroit-elle tous les fruits de son travail d'une année en vente, si
l'autre moitié refuse d'acheter, & s'obstine à garder par
épargne tout, ou forte partie de ses moyens de payer, la premiere
ne pourra pas tout vendre, ou vendra à perte : ce qui dérangera
& ruinera la culture, & les travaux de tous ceux qui n'en retiroient
précisément que leurs frais et qui ne pourroient continuer à
les retirer qu'autant qu'ils vendroient toute leur récolte, ou qu'ils
débiteroient tout leur magasin à un tel prix. Et il y
a toujours un très grand nombre de gens dans ce cas-là. Dans les Pays où les revenus se payent en argent, si ces revenus, qui représentent la partie disponible des récoltes, ne sont pas dépensés par les Propriétaires, il y aura justement une partie correspondante de la récolte qui ne sera pas débitée, & dont le Cultivateur aura cependant payé le prix aux Propriétaires, sans l'avoir retiré de ses ventes, par lesquelles seulement il avoit combiné pouvoir payer annuellement à ce Propriétaire la somme dont ils sont convenus. Cette partie de récolte in- |
|
| 129 | |
| baissera de prix : de l’autre côté, il y aura certainement beaucoup moins d’ar- | |
| vendue, & dont le Fermier voudra cependant se défaire tombera nécessairement à vil prix : ce vil prix influera tout aussi nécessairement sur les autres prix, qui se mettent naturellement de niveau, comme l'Auteur l'a très bien démontré (dans les paragraphes 33, 34 & 35 de son Ouvrage volume précédent, pages 32-38). Mais la diminution des prix nécessitera pareillement celle des réproductions, ainsi que nous venons de le voir en parlant de celles qui ne rendent que les frais ; & celles des revenus, qui sont toujours en raison de la quantité de productions à vendre, combinée avec le prix auquel elles sont vendues, & comparée avec les frais d'exploitation. Mais encore la diminution des revenus sera en perte pour les Propriétaires parcimonieux, qui auront peine à concevoir comment ils ont fait pour se ruiner en épargnant, et qui n'y verront de ressource que celle d'augmenter leurs épargnes. Ce qui précipitera la marche de leur ruine, jusqu'à ce qu'ils soient venus au point où la misere absolue leur rendra l'épargne impossible, & les forcera de se jetter, trop tard, dans les Classes laborieuses. | |
| 130 | |
| gent à prêter ; & comme beaucoup de gens se ruineront, il y aura vrai-sem- | |
| C'est ainsi
qu'à en juger, même par les seules lumieres de la raison, on pourroit
dire que l'avarice est un véritable péché mortel ; parcequ'elle fait mourir ceux qui auroient subsisté sur la dépense,
& que peu s'en faut qu'elle ne réduise au même terme, par un
chemin plus ou moins long, ceux qui font ce tort à la Société. Il ne s'en suit pas de là qu'il ne faille, pour entretenir la Société dans un état de richesse, pour animer la circulation, donner la subsistance à beaucoup de gens, & se soutenir soi-même dans l'aisance, que dépenser tout son revenu sans régle. Si l'avarice est le péché des sots, la prodigalité est celui des fous. Et cela est si reconnu, qu'ainsi que nous l'avons remarqué plus haut, l'on appelle généralement dépenses folles, celles qui dissipent sans objet, sans but, sans fruit, des revenus & des capitaux. Ce dont il s'agit n'est donc pas d'épargner les revenus, c'est encore moins de dépenser au hasard les capitaux. C'est de dépenser avec intelligence, tout ce que l'on peut dépenser pour payer des travaux utiles. Il n'en coute pas plus pour faire subsister un travailleur qu'un homme oisif. Il n'en coute pas plu |
|
| 131 | |
| blablement aussi plus d’emprunteurs. L’intérêt de l’argent augmentera donc, | |
| pour un travailleur productif ou du moins utile que, pour une autre espece de salarié dont l'utilité seroit nulle. C'est donc à ceux qui distribuent des salaires, à savoir qu'il vaut mieux employer des Laboureurs, des Vignerons, des Pâtres, des Maçons, des Pionniers, pour avoir des récoltes, pour soigner & multiplier des troupeaux, pour bâtir des maisons, pour creuser des canaux, &c. que des Musiciens et des Danseurs. Quoi, me dira-t-on ! Est-ce que vous voudriez empêcher les grands Propriétaires riches de payer des Musiciens et des Danseurs pour les divertir ? Certainement je ne voudrois, pour rien au monde, empêcher qui que ce soit de faire l'usage qu'il lui plait du revenu qui est à lui. Mais je dirai toujours que si ces Propriétaires veulent devenir plus riches, & rendre la dépense de leur revenu plus utile pour eux et pour les autres, ils auront raison de faire plutôt de la musique eux-mêmes, sans compter que la musique que l'on compose ou qu'on exécute fait dix fois plus de plaisir que celle que l'on paye : & quant aux ballets soudoyés, les jeunes demoiselles diront comme moi, qu'il vaudroit mieux qu'on leur laissât danser à elles-mêmes des contredanses | |
| 132 | |
| tandis que l’argent deviendra plus commun au marché & y baissera de prix, | |
| à leur gré, & qu'on employât la dépense des Danseurs à gages à améliorer la fortune de leurs peres & à grossir leur mariage. Les plaisirs des riches mêmes peuvent donc s'accorder avec leur intérêt bien entendu. On ne nous soupçonnera pas de solliciter des Loix somptuaires, car elles seroient prohibitives ; et toute Loi prohibitive d'une action ou d'une conduite qui n'attaque ni la liberté ni la propriété de personne, est elle-même un attentat contre le droit naturel, & une violation de la Loi primitive de la justice, qui doit servir de règle souveraine à toutes les Loix civiles & politiques. Mais sans aucune espece de prohibitions, les Chefs de la Société peuvent, par la seule influence de l'exemple & des distinctions, tourner les mœurs vers les travaux utiles plutôt que vers les dépenses folles, ou vers une épargne au moins stérile. Cette derniere paroit tenir le milieu entre les deux autres. On conçoit cependant combien elle est en elle-même différente de la bonne Administration. C'est celle-ci qui augmente véritablement les capitaux par des dépenses fructueuses. Telle est l'opinion même de l'Auteur, (voyez plus bas dans son dernier para- | |
| 133 | |
| & précisément par la même cause. | |
| On cessera d’être surpris de cette ap- | |
| graphe) dans lequel il dit très que, «les entrepreneurs ne font d'autre usage de l'argent qu'ils épargnent, que de le convertir sur-le-champ dans différentes natures d'effets sur lesquels roulent son entreprise. Et qu'ainsi cet argent rentre dans la circulation». C'est en effet par-là qu'il leur profite. D'où suit que ce ne sont pas réellement des épargnes ; mais des dépenses bien dirigées, qui sont la source de l'augmentation de leurs capitaux, & de l'amélioration de leur fortune. Et que s'il y a quelques momens où ils paroissent épargner réellement, parcequ'ils attendent, ou le tems le plus propre à l'emploi, ou l'accumulation d'une somme assez considérable pour les dépenses que cet emploi demande, cette épargne apparente n'est qu'une espece d'oscillation qui prépare à un plus grand cours de dépenses ; c'est ainsi, pour nous servir d'un proverbe commun, que l'on peut reculer un instant pour mieux sauter : ou si l'on veut une image plus vraie, c'est ainsi que lorsque la mer s'éleve, le flot s'arrête un instant, & recule même de quelques pouces, pour avancer ensuite de plusieurs toises. Il nous semble que c'est | |
| 134 | |
| parente bisarrerie, si l’on considere que l’argent qu’on offre au marché, pour avoir du bled est celui qu’on dépense journellement pour satisfaire à ses besoins, & que celui qu’on offre à prêter est précisément celui qu’on a retranché de ses dépenses journalieres pour le mettre en réserve & former des capitaux. | |
| §. L X X V I I I. | |
| Dans l’évaluation de l’argent comparé aux denrées, c’est l’argent considéré comme métal qui est l’objet de l’appréciation. Dans l’évaluation du denier de l’argent, c’est l’usage de l’argent pendant un tems déterminé qui est l’objet de l’appréciation. | |
| Au marché, une mesure de blé | |
| en ce sens que tout ce que l'Auteur dit de l'épargne, doit être entendu dans tout le reste de cet Ouvrage. | |
| 135 | |
| se balance avec un certain poids d’argent ; c’est une quantité d’argent qu’on achete avec la denrée ; c’est cette quantité qu’on apprécie, & qu’on compare avec d’autres valeurs étrangeres. Dans le prêt à l’intérêt, l’objet de l’appréciation est l’usage d’une certaine quantité de valeurs pendant un certain tems. Ce n’est plus une masse d’argent qu’on compare à une masse de bled , c’est une masse de valeurs qu’on compare avec une portion déterminée d’elle-même, qui devient le prix de l’usage de cette masse pendant un certain tems. Que vingt mille onces d’argent soient au marché l’équivalent de vingt mille mesures de bled, ou seulement de dix mille ; l’usage de ces vingt mille onces d’argent pendant un an n’en vaudra pas moins dans le commerce du prêt, la vingtieme partie de la somme principale, ou mille onces d’argent, si l’intérêt est au denier vingt. | |
| 136 | |
| §. L X X I X. | |
| Le prix de l’intérêt dépend immédiatement du rapport de la demande des emprunteurs avec l’offre des prêteurs; & ce rapport dépend principalement de la quantité de richesses mobiliaires accumulées par l’épargne des revenus & des produits annuels pour en former des capitaux, soit que ces capitaux existent en argent ou en tout autre genre d’effets ayant une valeur dans le commerce. | |
| Le prix de l’argent au marché n’est relatif qu’à la quantité de ce métal employée dans les échanges courans ; mais le taux de l’intérêt est relatif à la quantité de valeurs accumulées & mises en réserve pour former des capitaux. Il est indifférent que ces valeurs soient en métal ou en autres effets, pourvu que ces effets soient faciles à convertir en argent. Il s’en faut bien que la masse du métal qui existe dans un Etat soit aussi | |
| 137 | |
| forte que la somme des valeurs qui se prêtent à intérêt dans le cours d’une année: mais tous les capitaux en meubles, en marchandises, en outils, en bestiaux, tiennent lieu de cet argent, & le représentent. Un papier signé d’un homme qui a pour cent mille francs d’effets bien connus, & qui promet de payer cent mille francs à tel terme, se donne jusqu’à ce terme pour cent mille francs : tous les capitaux de celui qui a signé ce billet répondent du paiement, quelle que soit la nature des effets qu’il a en sa possession, pourvu qu’ils aient une valeur de cent mille francs. Ce n’est donc pas la quantité d’argent existant comme métal qui fait hausser ou baisser l’intérêt de l’argent, ou qui met dans le commerce plus d’argent offert à prêter ; c’est uniquement la somme de capitaux existante dans le commerce, c’est-à-dire, la somme actuelle des valeurs mobiliaires de toute espece, ac- | |
| 138 | |
| cumulées, épargnées successivement sur les revenus & les profits, pour être employées à procurer au possesseur de nouveaux revenus & de nouveaux profits. Ce sont ces épargnes accumulées (5) qui sont offertes aux emprunteurs ; & plus il y en a, plus l’intérêt de l’argent est bas, à moins que le nombre des emprunteurs ne soit augmenté à proportion. | |
| §. L X X X. | |
| L’esprit d’économie dans une nation augmente sans cesse la somme des capitaux ; le luxe tend sans cesse à les détruire. | |
| L’esprit d’économie (6) dans une nation | |
| (5) Voyez la note précédente. | |
| (6) Nous prions les Lecteurs de se rappeller que le mot d'économie doit être pris ici dans le sens de bonne administrations qui proscrit les dépenses folles, pour s'occuper avec intelligence des dépenses conservatrices & productives, Les avares qui épargnent beaucoup, sont de mauvais économes. Voyez la note 4. | |
| 139 | |
| tend à augmenter sans cesse la somme de ses capitaux, à accroître le nombre des prêteurs, à diminuer celui des emprunteurs. L’habitude du luxe fait précisément l’effet contraire ; &, par ce qui a déjà été remarqué sur l’usage des capitaux dans toutes les entreprises de culture, d’industrie ou de commerce, on peut juger si le luxe enrichit une nation, ou s’il l’appauvrit. | |
| §. L X X X I. | |
| L’abaissement de l’intérêt prouve qu’en général l’économie a prévalu, dans l’Europe, sur le luxe. | |
| Puisque l’intérêt de l’argent a sans cesse diminué en Europe depuis quelques siecles, il faut en conclure que l’esprit d’économie a été plus général que l’esprit de luxe. Il n’y a que les gens déja riches qui se livrent au luxe ; &, parmi les riches, tous ceux qui sont raisonnables se bornent à dépenser leur | |
| 140 | |
| revenu, & ont grande attention à ne point entamer leurs capitaux. Ceux qui veulent s’enrichir sont en bien plus grand nombre dans une nation que les riches : or, dans l’état actuel des choses, où toutes les terres sont occupées, il n’y a qu’un seul moyen de devenir riche, c’est d’avoir ou de se procurer, de quelque maniere que ce soit, un revenu ou un profit annuel au delà du nécessaire absolu pour sa subsistance, & de mettre chaque année ce superflu en réserve, pour en former un capital ; par le moyen duquel on puisse se procurer un accroissement de revenu ou de profit annuel, qu’on puisse encore épargner & convertir en capital. Il y a donc un grand nombre d’hommes intéressés & occupés à amasser des capitaux. | |
| 141 | |
| §. L X X X I I. | |
| Récapitulation des cinq différentes manieres d’employer les capitaux. | |
| J’ai compté cinq manieres différentes d’employer les capitaux, ou de les placer d’une maniere profitable. | |
| La premiere est d’acheter un fonds de terre qui rapporte un certain revenu. | |
| La seconde est de placer son argent dans des entreprises de culture, en affermant des terres dont les fruits doivent rendre, outre le prix du fermage, l’intérêt des avances & le prix du travail de celui qui consacre à leur culture & ses richesses & sa peine. | |
| La troisieme est de placer son capital dans des entreprises d’industrie ou de fabriques. | |
| La quatrieme est de le placer dans des entreprises de commerce. | |
| Et la cinquieme, de le prêter à ceux | |
| 142 | |
| qui en ont besoin, moyennant un intérêt annuel. | |
| §. L X X X I I I. | |
| Influence des différents emplois de l’argent les uns sur les autres. | |
| Il est évident que les produits annuels qu’on peut retirer des capitaux placés dans ces différents emplois sont bornés les uns par les autres, & tous relatifs au taux actuel de l’intérêt de l’argent. | |
| §. L X X X I V. | |
| L’argent placé en terre doit rapporter moins. | |
| Celui qui place son argent en achetant une terre affermée à un Fermier bien solvable, se procure un revenu qui ne lui donne que très peu de peine à recevoir, & qu’il peut dépenser de la maniere la plus agréable, en donnant carriere à tous ses goûts. Il a de plus l’avantage que la terre est de tous les | |
| 24 | |
| biens celui dont la possession est la plus assurée contre toute sorte d’accidents. | |
| §. L X X X V. | |
| L’argent prêté doit rapporter un peu plus que le revenu des terres acquises avec un capital égal. | |
| Celui qui prête son argent à intérêt, jouit encore plus paisiblement & plus librement que le possesseur de terre ; mais l’insolvabilité de son débiteur peut lui faire perdre son capital. Il ne se contentera donc pas d’un intérêt égal au revenu de la terre qu’il acheteroit avec le même capital. L’intérêt de l’argent prêté doit donc être plus fort que le revenu d’une terre achetée pour le même capital ; car si le prêteur trouvoit à acheter une terre d’un revenu égal, il préféreroit cet emploi (7). | |
| 144 | |
| §. L X X X V I. | |
| L’argent placé dans les entreprises de culture, de fabrique & de commerce, doit rapporter plus que l’intérêt de l’argent prêté. | |
| Par une raison semblable, l’argent | |
| (7) Quand l'Auteur
dit que l'intérêt de l'argent prêté doit être
plus fort que le revenu d'une terre achetée pour le même capital,
on sent bien qu'il ne veut pas dire que cela doive être ainsi statué
par les Loix. Il a très bien prouvé plus haut, (paragraphe 75
pag. 115.) que les Loix ne devoient point se mêler de fixer le taux de
l'intérêt de l'argent dans le Commerce. Ainsi, tout ce que sa phrase
signifie, est que la chose arrive naturellement. Quant aux Loix, elles ne peuvent jamais avoir à statuer que sur les intérêts judiciaires, comme celui qu'un Tuteur doit à son Pupille, ou qu'un Créancier peut exiger de son Débiteur, après la demande faite en Justice. Dans ce cas même, la Loi ne doit pas fixer le taux, mais se conformer au taux que présente le revenu des terres, constaté par des Actes de notoriété suffisante. Nous disons qu'elle doit se conformer au taux que présente le revenu des terres, quoique ce soit celui qui donne l'intérêt le plus [145] bas, parceque la Loi ne sauroit exiger d'un Tuteur ou de tout autre homme, plus que l'emploi qui assure le mieux la propriété de celui auquel appartient le capital qui est entre leurs mains ; & que cet emploi est évidemment l'achat d'une terre. Et aussi par d'autres raisons économiques, sur la source des moyens de payer l'intérêt : raisons qui ont été exposées, & qui seront encore développées ailleurs. |
|
| 145 | |
| employé dans l’agriculture, dans l’indus-trie, dans le commerce, doit rapporter un profit plus considérable que le revenu du même capital employé en terres où l’intérêt du même argent prêté ; car ces emplois exigeant outre le capital avancé, beaucoup de soins & de travail, s’ils n’étoient pas plus lucratifs, il vaudroit beaucoup mieux se procurer un revenu égal dont on pourroit jouir sans rien faire. Il faut donc qu’outre l’intérêt de son capital, l’entrepreneur retire chaque année un profit qui le récompense de ses soins, de son travail, de | |
| 146 | |
| ses talents, de ses risques, & qui de plus lui fournisse de quoi remplacer le dépérissement annuel de ses avances, qu’il est obligé de convertir dès le premier moment, en effets susceptibles d’al-tération, & qui sont exposés à toutes sortes d’accidents. | |
| §. L X X X V I I. | |
| Cependant les produits de ces différents emplois se limitent les uns par les autres, & se maintiennent malgré leur inégalité dans une espece d’équilibre. | |
| Les différents emplois des capitaux rapportent donc des produits très inégaux ; mais cette inégalité n’empêche pas qu’ils n’influent réciproquement les uns sur les autres, & qu’il ne s’établisse entr’eux une espece d’équilibre, comme entre deux liqueurs inégalement pesantes, & qui communiqueroient ensemble par le bas d’un siphon renversé, dont elles occuperoient les deux branches : | |
| 147 | |
| elles ne seroient pas de niveau, mais la hauteur de l’une ne pourroit augmenter sans que l’autre ne montât aussi dans la branche opposée. | |
| Je suppose que tout-à-coup un très grand nombre de propriétaires de terres veuillent les vendre. Il est évident que le prix des terres baissera, & qu’avec une somme moindre on acquerra un plus grand revenu : cela ne peut arriver sans que l’intérêt de l’argent ne devienne plus haut, car les possesseurs d’argent aimeront mieux acheter des terres que de le prêter à un intérêt qui ne seroit pas plus fort que le revenu des terres qu’ils acheteroient. Si donc les emprunteurs veulent avoir de l’argent, ils seront obligés d’en payer un loyer plus fort. Si l’intérêt de l’argent devient plus haut, on aimera mieux le prêter que de le faire valoir d’une maniere plus pénible & plus risquable, dans les entreprises de culture, d’industrie & de commerce, & l’on | |
| 148 | |
| ne fera d’entreprises que celles qui rapporteront, outre les salaires du travail, un profit beaucoup plus grand que le taux de l’argent prêté. En un mot, dès que les profits résultants d’un emploi quelconque de l’argent augmentent ou diminuent, les capitaux s’y versent en se retirant des autres emplois, ou s’en retirent en se versant sur les autres emplois ; ce qui change nécessairement dans chacun de ces emplois le rapport du capital au produit annuel. En général, l’argent converti en fond de terre, rapporte moins que l’argent prêté, & l’argent prêté rapporte moins que l’argent employé dans les entreprises laborieuses, mais le produit de l’argent employé de quelque maniere que ce soit, ne peut augmenter ou diminuer, sans que tous les autres emplois éprouvent une augmentation ou une diminution pro-portionnée. | |
| 149 | |
| §. L X X X V I I I. | |
| L’intérêt courant de l’argent est le thermomètre par où l’on peut juger de l’abondance ou de la rareté des capitaux ; il est la mesure de l’étendue qu’une Nation peut donner à ses entreprises de culture, de fabrique & de commerce. | |
| L’intérêt courant de l’argent prêté peut donc être regardé comme une espece de thermomètre de l’abondance ou de la rareté des capitaux chez une Nation, & de l’étendue des entreprises de toute espece auxquelles elle peut se livrer : il est évident que plus l’intérêt de l’argent est bas, plus les terres ont de valeur. Un homme qui a cinquante mille livres de rentes, si les terres ne se vendent qu’au denier vingt, n’a qu’une richesse d’un million, il a deux millions si les terres se vendent au denier quarante. | |
| Si l’intérêt est à cinq pour cent, toute terre à défricher, dont | |
| 150 | |
| les produits ne rapporteront pas cinq pour cent, outre le remplacement des avances & la récompense des soins du Cultivateurs, restera en friche. Toute fabrique, tout commerce qui ne rapporteront pas cinq pour cent, outre le salaire des peines & les risques de l’entrepreneur, n’existeront pas. S’il y a une Nation voisine chez laquelle l’intérêt ne soit qu’à deux pour cent, non-seulement elle fera tous les commerces dont la Nation, où l’intérêt est à cinq pour cent se trouve exclue, mais encore ses fabriquants & ses négociants, pouvant se contenter d’un profit moindre, établiront leurs denrées à plus bas prix dans tous les marchés, & s’attireront le commerce presque exclusif de toutes les choses dont des circonstances particulieres, ou la trop grande cherté des frais de voitures, ne conserveront pas le commerce à la nation où l’argent vaut cinq pour cent. | |
| 151 | |
| §. L X X X I X. | |
| Influence du taux de l’intérêt de l’argent sur toutes les entreprises lucratives. | |
| On peut regarder le prix de l’intérêt comme une espece de niveau au-dessous duquel tout travail, toute culture, toute industrie, tout commerce cesse. C’est comme une mer répandue sur une vaste contrée : les sommets des montagnes s’élèvent au dessus des eaux, & forment des îles fertiles & cultivées. Si cette mer vient à s’écouler, à mesure qu’elle descend, les terreins en pente, puis les plaines & les vallons, paroissent & se couvrent de productions de toute espece. Il suffit que l’eau monte ou s’abaisse d’un pied pour inonder ou pour rendre à la culture des plages immenses. C’est l’abondance des capitaux qui anime toutes les entreprises ; & le bas intérêt de l’argent est tout à la fois | |
| 152 | |
| l’effet & l’indice de l’abondance des capitaux. | |
| §. X C. | |
| La richesse totale d’une nation est composée 1°. du revenu net de tous les biens-fonds multiplié par le taux du prix des terres, 2°. de la somme de toutes les richesses mobiliaires existantes dans la nation. | |
| Les biens-fonds équivalent à un capital égal à leur revenu annuel multiplié par le denier courant auquel les terres se vendent. Ainsi, si l’on additionnoit le revenu de toutes les terres, c’est-à-dire, le revenu net qu’elles rendent aux propriétaires, & à toux ceux qui en partagent la propriété, comme le Seigneur qui perçoit une rente, le Curé qui perçoit la dixme, le Souverain qui perçoit l’impôt ; si, dis-je, on additionnoit toutes ces sommes, & qu’on les multipliât par le taux auquel | |
| 153 | |
| se vendent les terres, on auroit la somme des richesses d’une nation en biens-fonds. Pour avoir la totalité des richesses d’une nation, il faut y joindre les richesses mobiliaires, qui consistent dans la somme des capitaux employés dans toutes les entreprises de culture, d’industrie & de commerce (8), & qui n’en sortent jamais, toutes les avances en tout genre d’entreprise devant sans cesse rentrer aux entrepreneurs, pour être sans cesse reversées dans l’entreprise, qui, sans cela, ne pourroit être continuée. Ce seroit une erreur bien grossiere | |
| (8) Ce que l'Auteur appelle ici, par un terme général, la totalité des richesses d'une Nation, est en effet la totalité des richesses stables & durables, des capitaux, qui sont les moyens qui lui servent à se procurer les productions ou les richesses de consommation annuellement renaissantes qui la font subsister : lesquelles ne doivent pas être confondues avec la valeur des biens fonds, ni avec celles des capitaux employés à la culture de ces biens, ou aux autres entreprises d'industrie ou de commerce. | |
| 154 | |
| de confondre la masse immense de ces richesses mobiliaires avec la masse d’argent qui existe dans un Etat ; celle-ci n’est qu’un très petit objet en comparaison. Il suffit, pour s’en convaincre, de se représenter l’immense quantité de bestiaux, d’outils, de semences qui constituent les avances de l’agriculture ; de matieres d’instrumens, de meubles de toute espece qui font le fonds du manufacturier, les magasins de tous les marchands & de tous les commerçans ; & l’on sentira que, dans la totalité des richesses, soit foncieres soit mobiliaires, d’une nation, l’argent en nature n’en fait qu’une très petite partie. Mais toutes ces richesses & l’argent étant continuellement échangeables, toutes représentent l’argent, & l’argent les représente toutes. | |
| 155 | |
| §. X C I. | |
| La somme des capitaux prêtés ne pourroit y être comprise sans double emploi. | |
| Il ne faut pas comprendre dans le calcul des richesses de la nation la somme des capitaux prêtés ; car ces capitaux n’ont pu être prêtés qu’à des propriétaires de terres, ou à des entrepreneurs pour les faire valoir dans leurs entreprises, puisqu’il n’y a que ces deux sortes de personnes qui puissent répondre du capital & payer l’intérêt : un argent prêté à des gens qui n’auroient ni fonds ni industrie, seroit un capital éteint, & non un capital employé. Si le propriétaire d’une terre de quatre cents mille francs en emprunte cent, son bien est chargé d’une rente qui diminue d’autant son revenu ; &, s’il vendoit son bien, sur les quatre cents mille francs qu’il recevroit, il en appartiendroit cent au prêteur. Le capital du prêteur forme- | |
| 156 | |
| roit donc, dans le calcul des richesses existantes, un double emploi avec une partie égale de la valeur de la terre. La terre vaut toujours quatre cents mille francs : quand le propriétaire a emprunté cents mille francs, cela ne fait pas cinq cents mille francs ; cela fait seulement que, sur les quatre cents mille, il en appartient cent mille au prêteur, & qu’il n’en appartient plus que trois cents à l’emprunteur. | |
| Le même double emploi auroit lieu si l’on faisoit entrer dans le calcul total des capitaux l’argent prêté à un entrepreneur pour être employé aux avances de son entreprise ; car ce prêt n’augmente pas la somme totale des avances nécessaires à l’entreprise, il en résulte seulement que cette somme, & la partie des profits qui en représente l’intérêt, appartiennent au prêteur. Qu’un commerçant emploie dix mille francs de son bien dans son commerce & en | |
| 157 | |
| tire tout le profit, ou qu’il ait emprunté ces dix mille francs à un autre auquel il en paie l’intérêt, en se contentant du surplus du profit & du salaire de son industrie, ce n’est jamais que dix mille francs. | |
| Mais si l’on ne peut comprendre, sans faire un double emploi, dans le calcul des richesses d’une nation le capital des intérêts de l’argent prêté, l’on doit y faire entrer tous les autres biens meubles, qui, quoique formant originairement un objet de dépense, & ne portant aucun profit, deviennent cependant par leur durée un vrai capital qui s’accumule sans cesse, & qui, pouvant au besoin être échangé contre de l’argent, fait comme un fonds en réserve qui peut rentrer dans le commerce, & suppléer, quand on voudra, à la perte d’autres capitaux. Tels sont les meubles de toute espece, les bijoux, la vaisselle, les tableaux, les statues, | |
| 158 | |
| l’argent comptant enfermé dans le coffre des avares : toutes ces choses ont une valeur, & la somme de toutes ces valeurs peut être un objet considérable dans les nations riches : mais, considérable ou non, toujours est-il vrai qu’il doit être ajouté à la somme du prix des biens fonds, & à celle des avances circulantes dans les entreprises de tout genre, pour former la somme totale des richesses d’une nation. Au reste il n’est pas besoin de dire que, quoiqu’on puisse très bien définir, comme on vient de le faire, en quoi consiste la totalité des richesses d’une nation, il est vrai-semblablement impossible de découvrir à combien elles se montent ; à moins que l’on ne trouve quelque régle pour fixer la proportion du commerce total d’une nation avec le revenu de ses terres : chose faisable peut-être, mais qui n’a pas encore été exécutée d’une maniere à lever tous les doutes. | |
| 159 | |
| §. X C I I. | |
| Dans laquelle des trois classes de la Société doit-on ranger les capitalistes prêteurs d’argent ? | |
| Voyons maintenant comment ce que nous venons de développer sur les différentes manieres d’employer les capitaux s’accorde avec ce que nous avons précédemment établi sur le partage de tous les membres de la Société en trois classes, la classe productrice ou des agriculteurs, la classe industrieuse ou commerçante, & la classe disponible ou des propriétaires. | |
| §. X C I I I. | |
| Le capitaliste prêteur d’argent appartient, quant à sa personne, à la classe disponible. | |
| Nous avons vu que tout homme riche est nécessairement possesseur ou d’un capital en richesses mobiliaires, ou d’un | |
| 160 | |
| fonds équivalent à un capital. Tout fonds de terre équivaut à un capital ; ainsi tout propriétaire est capitaliste, mais tout capitaliste n’est pas propriétaire de biens fonds ; & le possesseur d’un capital mobilier a le choix, ou de l’employer à acquérir des fonds, ou de le faire valoir dans des entreprises de la classe cultivatrice ou de la classe industrieuse. Le capitaliste, devenu entrepreneur de culture ou d’industrie, n’est pas plus disponible, ni lui, ni ses profits, que le simple ouvrier de ces deux classes ; tous deux sont affectés à la continuation de leurs entreprises. Le capitaliste qui se réduit â n’être que prêteur d’argent, ou prête à un propriétaire, ou à un entrepreneur. S’il prête à un propriétaire, il paroît appartenir à la classe des propriétaires; il devient copartageant de la propriété ; le revenu de la terre est affecté au paiement de l’intérêt de sa créance ; la valeur du | |
| 161 | |
| fonds est affectée à la sûreté de son capital jusqu’à due concurrence. Si le prêteur d’argent a prêté à un entrepreneur, il est certain que sa personne appartient à la classe disponible ; mais son capital reste affecté aux avances de l’entreprise, & ne peut en être retiré sans nuire à l’entreprise, ou sans être remplacé par un capital d’égale valeur. | |
| §. X C I V. | |
| L’intérêt que retire le prêteur d’argent est disponible, quant a l’usage qu’il en peut faire. | |
| A la vérité, l’intérêt qu’il tire de ce capital semble être disponible, puisque l’entrepreneur & l’entreprise peuvent s’en passer ; & il semble aussi qu’on puisse en conclure que, dans les profits des deux classes laborieuses employées soit à la culture, soit à l’industrie, il y en a une portion disponible, savoir, celle qui répond à l’intérêt des avances | |
| 162 | |
| calculé sur le pied courant de l’intérêt de l’argent prêté ; & il semble encore que cette conclusion donne atteinte à ce que nous avons dit, que la seule classe des propriétaires avoit un revenu proprement dit, un revenu disponible, & que tous les membres des deux autres classes n’avoient que des salaires ou des profits. Ceci mérite quelque éclaircissement. Si l’on considere les mille écus que retire chaque année un homme qui a prêté soixante mille francs à un commerçant par rapport à l’usage qu’il en peut faire, nul doute qu’ils ne soient parfaitement disponibles, puisque l’en-treprise peut s’en passer. | |
| §. X C V. | |
| L’intérêt de l’argent n’est pas disponible dans ce sens, que l’Etat puisse sans inconvénient s’en approprier une partie dans ses besoins. | |
| Mais il ne s’ensuit pas qu’ils soient | |
| 163 | |
| disponibles dans le sens que l’Etat puisse s’en approprier impunément une portion pour les besoins publics. Ces mille écus ne sont point une rétribution que la culture ou le commerce rende gratuitement à celui qui a fait les avances ; c’est le prix & la condition de cette avance, sans laquelle l’entreprise ne pourroit subsister. Si cette rétribution est diminuée, le capitaliste retirera son argent, & l’entreprise cessera. Cette rétribution doit donc être sacrée & jouir d’une immunité entiere, parcequ’elle est le prix d’une avance faite à l’entreprise, sans laquelle l’entreprise ne pourroit subsister. Y toucher, ce seroit augmenter le prix des avances de toutes les entreprises, & par conséquent diminuer les entreprises elles-mêmes, c’est-à-dire, la culture, l’industrie & le commerce. | |
| Ceci doit faire comprendre ce que nous avons dit que le capitaliste qui | |
| 164 | |
| avoit prêté à un propriétaire paroissoit appartenir à la classe propriétaire, cette apparence avoit quelque chose d’équivoque qui avoit besoin d’être démêlé. En effet, il est exactement vrai que l’intérêt de son argent n’est pas plus disponible, c’est-à-dire, n’est pas plus susceptible de retranchement, que celui de l’argent prêté aux entrepreneurs de culture & de commerce. Cet intérêt est également le prix de la convention libre, & l’on ne peut pas plus en retrancher sans altérer ou changer le prix du prêt : or il importe peu à qui le prêt ait été fait ; si le prix du prêt change & augmente pour le propriétaire, il changera & augmentera pour le cultivateur, le manufacturier & le commerçant. En un mot, le capitaliste prêteur d’argent doit être considéré comme marchand d’une denrée absolument nécessaire à la production des richesses, & qui ne sauroit être | |
| 165 | |
| à trop bas prix. Il est aussi déraisonnable de charger son commerce d’un impôt, que de mettre un impôt sur le fumier qui sert à engraisser les terres. Concluons de là que le prêteur d’argent appartient bien à la classe disponible, quant à sa personne, parcequ’il n’a rien à faire ; mais non quant à la nature de sa richesse, soit que l’intérêt de son argent soit payé par le propriétaire des terres sur une portion de son revenu, soit qu’il soit payé par un entrepreneur sur la partie de ses profits affectée à l’intérêt des avances. | |
| §. X C V I. | |
| Objection. | |
| On me dira sans doute que le capitaliste a pu indifféremment, ou prêter son argent, ou l’employer en acquisition de terres ; que, dans l’un & l’autre cas, il ne tire qu’un prix équivalent de son argent, & que, de quelque façon | |
| 166 | |
| qu’il l’ait employé, il ne doit pas moins contribuer aux dépenses publiques. | |
| §. X C V I I. | |
| Réponse a l'objection. | |
| Je réponds premiérement, qu’à la vérité, lorsque le capitaliste a acheté une terre, le revenu équivaut pour lui à ce qu’il auroit retiré de son argent en le prêtant ; mais il y a cette différence essentielle pour l’Etat, que le prix qu’il donne pour sa terre ne contribue en rien au revenu qu’elle produit ; elle n’en auroit pas donné moins de revenu quand il ne l’auroit pas achetée : ce revenu est, comme nous l’avons expliqué, ce que la terre donne au-delà du salaire des cultivateurs, de leurs profits, & de l’intérêt des avances. Il n’en est pas de même de l’intérêt du prêt ; il est la condition même du prêt, le prix de l’avance, sans laquelle le re- | |
| 167 | |
| venu ou les profits qui servent à le payer n’existeroient pas. | |
| Je réponds, en second lieu, que, si les terres étoient chargées seules de la contribution aux dépenses publiques, dès qu’une fois cette contribution seroit réglée, le capitaliste qui les acheteroit ne compteroit pas dans l’intérêt de son argent la partie du revenu affectée à cette contribution : de même qu’un homme qui achete aujourd’hui une terre, n’achete pas la dixme que reçoit le Curé, mais le revenu qui reste, déduction faite de cette dixme. | |
| §. X C V I I I. | |
| Il n’existe de revenu vraiment disponible dans un Etat, que le produit net des terres. | |
| On voit, par ce qui a été dit, que l’intérêt de l’argent prêté est pris sur le revenu des terres, ou sur les profits des entreprises de culture, d’industrie ou de | |
| 168 | |
| commerce. Mais ces profits eux-mêmes, nous avons déja démontré qu’ils étoient seulement une part de la production des terres ; que le produit des terres se partageoit en deux portions ; que l’une étoit affectée aux salaires du cultivateur, à ses profits, à la rentrée & à l’intérêt de ses avances ; & que l’autre étoit la part du propriétaire, ou le revenu que le propriétaire dépensoit à son gré, & dont il contribuoit aux dépenses générales de l’Etat. Nous avons démontré que tout ce que reçoivent les autres classes de la Société n’étoit que les salaires & les profits payés, soit par le propriétaire sur son revenu, soit par les agents de la classe productrice sur la partie affectée à leurs besoins, qu’ils sont obligés d’acheter de la classe industrieuse. Que ces profits soient distribués en salaires d’ouvriers, en profits d’entrepreneurs, en intérêts d’avances, ils ne changent pas de nature, & n’augmentent point la | |
| 169 | |
| somme du revenu produit par la classe productrice en sus du prix de son travail, à laquelle la classe industrieuse ne participe que jusqu’à concurrence du prix de son travail. | |
| Il reste donc constant qu’il n’y a de revenu que le produit net des terres & que tout autre profit annuel, ou est payé par le revenu, ou fait partie des frais qui servent à produire le revenu. | |
| §. X C I X. | |
| La terre a aussi fourni la totalité des richesses mobiliaires ou capitaux existants, & qui ne sont formés que par une portion de ses productions réservées chaque année. | |
| Non seulement il n’existe ni ne peut exister d’autre revenu que le produit net des terres, mais c’est encore la terre qui a fourni tous les capitaux qui forment la masse de toutes les avances de la culture & du commerce. Elle a offert | |
| 170 | |
| sans culture les premieres avances grossieres & indispensables des premiers travaux ; tout le reste est le fruit accumulé de l’économie des siecles qui se sont succédés depuis qu’on commence à cultiver la terre. Cette économie a lieu sans doute, non seulement sur les revenus des propriétaires, mais encore sur les profits de tous les membres des classes laborieuses. Il est même généralement vrai que, quoique les propriétaires aient plus de superflu, ils épargnent moins, parcequ’ayant plus de loisir, ils ont plus de desirs, plus de passions ; ils se regardent comme plus assurés de leur fortune ; ils songent plus à en jouir agréablement qu’à l’augmenter : le luxe est leur partage. Les salariés, & sur-tout les entrepreneurs des autres classes, recevant des profits proportionnés à leurs avances, à leurs talents, à leur activité, ont, quoiqu’ils n’aient pas de revenu proprement dit, un superflu au- | |
| 171 | |
| delà de leur subsistance ; & presque tous, livrés uniquement à leurs entreprises, occupés à accroître leur fortune, détournés par leur travail des amusements & des passions dispendieuses, ils épargnent tout leur superflu pour le reverser dans leur entreprise & l’augmenter. La plupart des entrepreneurs de culture empruntent peu, & presque tous ne font valoir que leurs propres fonds. Les entrepreneurs des autres travaux, qui veulent rendre leur fortune solide, s’efforcent aussi d’en venir là ; &, à moins d’une grande habileté, ceux qui font leurs entreprises sur des fonds d’emprunt risquent beaucoup d’échouer. Mais, quoique les capitaux se forment en partie par l’épargne des profits des classes laborieuses, cependant, comme ces profits viennent toujours de la terre, puisque tous sont payés, ou sur le revenu, ou sur les frais qui servent à produire le revenu, il est évident que | |
| 172 | |
| les capitaux viennent de la terre tout comme le revenu, ou plutôt qu’ils ne sont que l’accumulation de la partie des valeurs produites par la terre que les propriétaires du revenu, ou ceux qui le partagent, peuvent mettre en réserve chaque année, sans l’employer à leurs besoins. | |
| §. C. | |
| Quoique l’argent soit l’objet direct de l’épargne, & qu’il soit, pour ainsi dire, la matiere premiere des capitaux dans leur formation, l’argent en nature ne forme qu’une partie presque insensible de la somme totale des capitaux. | |
| Nous avons vu que l’argent n’entre presque pour rien dans la somme totale des capitaux existants ; mais il entre pour beaucoup dans la formation des capitaux. En effet, presque toutes les épargnes ne se font qu’en argent ; c’est en argent que les revenus rentrent | |
| 173 | |
| aux propriétaires, que les avances & les profits rentrent aux entrepreneurs en tous genres ; c’est donc de l’argent qu’ils épargnent, & l’accroissement annuel des capitaux se fait en argent : mais tous les entrepreneurs n’en font d’autre usage que de le convertir sur-le-champ dans différentes natures d’effets sur lesquels roule leur entreprise ; ainsi cet argent rentre dans la circulation, & la plus grande partie des capitaux n’existent qu’en effets de différentes natures, comme nous l’avons déjà expliqué plus haut. | |
Novembre 1766. |
|