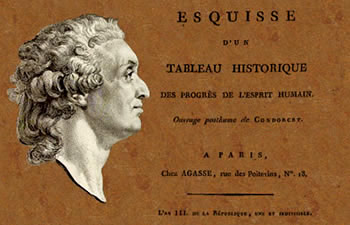|
( 30 )
DEUXIEME EPOQUE.
LES PEUPLES PASTEURS.
Passage de cet état à celui des peuples
agriculteurs.
L’idée de conserver les animaux pris à la chasse
dut se
présenter aisément, lorsque la douceur de ces animaux en rendoit
la garde facile, que le terrain des habitations leur fournissoit une nourriture
abondante, que la famille avoit du superflu, et qu’elle pouvoit
craindre d’être réduite à la disette par le mauvais
succès d’une autre chasse, ou par l’intempérie des saisons.
 Après avoir gardé ces animaux comme une simple provision, l’on observa
qu’ils pouvoient se multiplier, et offrir par-là une ressource
plus durable. Leur lait en présentoit une nouvelle ; et ces produits
d’un troupeau qui, d’abord, n’étoient qu’un supplément à celui
de la chasse, devinrent un Après avoir gardé ces animaux comme une simple provision, l’on observa
qu’ils pouvoient se multiplier, et offrir par-là une ressource
plus durable. Leur lait en présentoit une nouvelle ; et ces produits
d’un troupeau qui, d’abord, n’étoient qu’un supplément à celui
de la chasse, devinrent un
( 31 )
moyen de subsistance plus assuré, plus abondant,
moins pénible. La chasse cessa donc d’être le premier, et
ensuite, d’être même comptée au nombre de ces moyens
; elle ne fut plus conservée que comme un plaisir, comme une
précaution nécessaire pour éloigner les
bêtes féroces des troupeaux qui, étant devenus plus nombreux,
ne pouvoient plus trouver une nourriture suffisante autour des
habitations.
 Une vie
plus sédentaire, moins fatigante, offroit un loisir favorable
au développement de
l’esprit humain. Assurés de leur subsistance, n’étant plus inquiets
pour leurs premiers besoins, les hommes cherchèrent des sensations nouvelles
dans les moyens d’y pourvoir. Une vie
plus sédentaire, moins fatigante, offroit un loisir favorable
au développement de
l’esprit humain. Assurés de leur subsistance, n’étant plus inquiets
pour leurs premiers besoins, les hommes cherchèrent des sensations nouvelles
dans les moyens d’y pourvoir.
 Les arts
firent quelques progrès ; on acquit quelques lumières
sur celui de nourrir les animaux domestiques, d’en favoriser la reproduction,
et même d’en perfectionner les espèces. Les arts
firent quelques progrès ; on acquit quelques lumières
sur celui de nourrir les animaux domestiques, d’en favoriser la reproduction,
et même d’en perfectionner les espèces.
 On apprit à employer la laine pour les vêtemens, à substituer
l’usage des tissus à celui des peaux. On apprit à employer la laine pour les vêtemens, à substituer
l’usage des tissus à celui des peaux.
( 32 )
 La société dans
les familles devint plus douce, sans devenir moins intime. Comme les
troupeaux de chacune de ces familles ne pouvoient
se multiplier avec égalité, il s’établit une différence
de richesse. Alors, on imagina de partager le produit de ses troupeaux avec un
homme qui n’en avoit pas, et qui devoit consacrer son temps et ses forces aux
soins qu’ils exigent. Alors, on vit que le travail d’un individu jeune, bien
constitué, valoit plus que ne coûtoit sa subsistance rigoureusement
nécessaire ; et l’on prit l’habitude de garder les prisonniers de guerre
pour esclaves, au lieu de les égorger. La société dans
les familles devint plus douce, sans devenir moins intime. Comme les
troupeaux de chacune de ces familles ne pouvoient
se multiplier avec égalité, il s’établit une différence
de richesse. Alors, on imagina de partager le produit de ses troupeaux avec un
homme qui n’en avoit pas, et qui devoit consacrer son temps et ses forces aux
soins qu’ils exigent. Alors, on vit que le travail d’un individu jeune, bien
constitué, valoit plus que ne coûtoit sa subsistance rigoureusement
nécessaire ; et l’on prit l’habitude de garder les prisonniers de guerre
pour esclaves, au lieu de les égorger.
 L’hospitalité, qui se pratique aussi chez les sauvages, prend
chez les peuples pasteurs un caractère plus prononcé, plus
solennel, même parmi ceux qui errent dans des chariots ou sous
des tentes. Il s’offre de plus fréquentes occasions de l’exercer
réciproquement d’individu à individu, de famille à famille,
de peuple à peuple. Cet acte d’humanité devient un devoir
social, et on l’assujettit à des règles. L’hospitalité, qui se pratique aussi chez les sauvages, prend
chez les peuples pasteurs un caractère plus prononcé, plus
solennel, même parmi ceux qui errent dans des chariots ou sous
des tentes. Il s’offre de plus fréquentes occasions de l’exercer
réciproquement d’individu à individu, de famille à famille,
de peuple à peuple. Cet acte d’humanité devient un devoir
social, et on l’assujettit à des règles.
 Enfin,
comme certaines familles avoient non- Enfin,
comme certaines familles avoient non-  seulement seulement
(
33 ) non-seulement une subsistance assurée, mais un superflu constant, et
que d’autres hommes manquoient du nécessaire, la compassion naturelle
pour leurs souffrances fit naître le sentiment et l’habitude de
la bienfaisance.
Les moeurs durent s’adoucir ; l’esclavage des femmes eut moins de dureté,
et celles des riches cessèrent d’être condamnées à des
travaux pénibles.
Plus de variété dans les choses employées à satisfaire
les divers besoins, dans les instrumens qui servoient à les préparer,
plus d’inégalité dans leur distribution, durent multiplier
les échanges, et produire un véritable commerce ; il ne
put s’étendre sans faire sentir la nécessité d’une
mesure commune, d’une espèce de monnoie.
Les peuplades devinrent plus nombreuses : en mêmetemps, afin de nourrir
plus facilement les troupeaux, les habitations se séparèrent
davantage quand elles restèrent
fixes
: ou bien, elles se changèrent
en campemens mobiles, quand les hommes eurent
 C C
(34 )
appris à employer, pour porter ou traîner les fardeaux,
de quelques-unes des espèces d’animaux qu’ils avoient subjuguées.
 Chaque nation eut
un chef pour la guerre ; mais s’étant divisée
en plusieurs tribus, par la nécessité de s’assurer des
pâturages, chaque tribu eut aussi le sien. Presque par-tout,
cette supériorité fut attachée à certaines
familles. Les chefs de famille qui avoient de nombreux troupeaux, beaucoup
d’esclaves,
qui employoient à leur service un grand nombre de citoyens plus
pauvres, partagèrent l’autorité des chefs de leur tribu,
comme ceux-ci partageoient celle des chefs de nation ; du moins, lorsque
le respect dû à l’âge, à l’expérience,
aux exploits, leur en donnoit le crédit : et c’est à cette époque
de la société qu’il faut placer l’origine de l’esclavage
et de l’inégalité de droits politiques entre
les hommes parvenus à l’âge de la maturité. Chaque nation eut
un chef pour la guerre ; mais s’étant divisée
en plusieurs tribus, par la nécessité de s’assurer des
pâturages, chaque tribu eut aussi le sien. Presque par-tout,
cette supériorité fut attachée à certaines
familles. Les chefs de famille qui avoient de nombreux troupeaux, beaucoup
d’esclaves,
qui employoient à leur service un grand nombre de citoyens plus
pauvres, partagèrent l’autorité des chefs de leur tribu,
comme ceux-ci partageoient celle des chefs de nation ; du moins, lorsque
le respect dû à l’âge, à l’expérience,
aux exploits, leur en donnoit le crédit : et c’est à cette époque
de la société qu’il faut placer l’origine de l’esclavage
et de l’inégalité de droits politiques entre
les hommes parvenus à l’âge de la maturité.
 Ce furent les conseils formés
des chefs de famille ou de tribu qui, d’après la justice naturelle, ou d’après
les usages reconnus, décidèrent les contestations, déjà plus
nombreuses et Ce furent les conseils formés
des chefs de famille ou de tribu qui, d’après la justice naturelle, ou d’après
les usages reconnus, décidèrent les contestations, déjà plus
nombreuses et
( 35 )
plus compliquées. La tradition de ces jugemens, en attestant
les usages, en les perpétuant, forma bientôt une espèce
de jurisprudence plus régulière, plus constante, que d’ailleurs
les progrès de la société avoient rendue nécessaire.
L’idée de la propriété et de ses droits avoit acquis
plus d’étendue et de précision. Le partage des successions,
devenu plus important, avoit besoin d’être assujetti à des
règles fixes. Les conventions plus fréquentes ne se bornoient
plus à des objets aussi simples ; elles durent être soumises à des
formes ; la manière d’en constater l’existence, pour en assurer
l’exécution, eut aussi ses lois.
 L’utilité de
l’observation des étoiles, l’occupation qu’elles
offroient pendant de longues veilles, le loisir dont jouissoient les
bergers, durent amener quelques foibles progrès dans l’astronomie. L’utilité de
l’observation des étoiles, l’occupation qu’elles
offroient pendant de longues veilles, le loisir dont jouissoient les
bergers, durent amener quelques foibles progrès dans l’astronomie.
 Mais en même temps on vit se perfectionner l’art de tromper les
hommes pour les dépouiller, et d’usurper sur leurs opinions une
autorité fondée sur des craintes et des espérances
chimériques. Il s’établit Mais en même temps on vit se perfectionner l’art de tromper les
hommes pour les dépouiller, et d’usurper sur leurs opinions une
autorité fondée sur des craintes et des espérances
chimériques. Il s’établit
 C 2 C 2
( 36 )
des cultes plus réguliers, des systêmes de croyance
moins grossièrement combinés. Les idées des puissances
surnaturelles se raffinèrent en quelque sorte : et à côté de ces
opinions, on vit s’établir ici des princes pontifes, là des
familles ou des tribus sacerdotales, ailleurs des collèges de
prêtres
; mais toujours une classe d’individus affectant d’insolentes prérogatives,
se séparant des hommes pour les mieux asservir, et cherchant à s’emparer
exclusivement de la médecine,
de l’astronomie, pour réunir tous les moyens de subjuguer les
esprits, pour ne leur en laisser aucun de démasquer son hypocrisie,
de briser ses fers.
 Les langues s’enrichirent
sans devenir moins figurées ou moins
hardies. Les images qu’elles employoient furent plus variées et
plus douces : on les prit dans la vie pastorale, comme dans celle des
forêts, dans les phénomènes réguliers de la
nature, comme dans ses bouleversemens. Le chant, les instrumens, la
poésie se perfectionnèrent dans un loisir qui les
soumettoit à des auditeurs plus paisibles, et dès-lors plus
difficiles,
qui
permettoit d’observer ses Les langues s’enrichirent
sans devenir moins figurées ou moins
hardies. Les images qu’elles employoient furent plus variées et
plus douces : on les prit dans la vie pastorale, comme dans celle des
forêts, dans les phénomènes réguliers de la
nature, comme dans ses bouleversemens. Le chant, les instrumens, la
poésie se perfectionnèrent dans un loisir qui les
soumettoit à des auditeurs plus paisibles, et dès-lors plus
difficiles,
qui
permettoit d’observer ses
( 37 )
propres sentimens, de juger ses premières idées, et de
choisir entre elles.
 L’observation a dû faire
remarquer que certaines plantes offroient aux troupeaux une subsistance
meilleure ou plus abondante : on a senti
l’utilité d’en favoriser la production, de les séparer
des autres plantes qui ne donnoient qu’une nourriture foible, mal-saine,
même dangereuse ; et l’on est parvenu à en trouver les moyens. L’observation a dû faire
remarquer que certaines plantes offroient aux troupeaux une subsistance
meilleure ou plus abondante : on a senti
l’utilité d’en favoriser la production, de les séparer
des autres plantes qui ne donnoient qu’une nourriture foible, mal-saine,
même dangereuse ; et l’on est parvenu à en trouver les moyens.
 De même, dans
les pays où des plantes, des graines, des
fruits spontanément offerts par le sol, contribuoient, avec les
produits des troupeaux, à la nourriture de l’homme, on a dû observer
aussi comment ces végétaux se multiplioient ; et, dès-lors,
chercher à les rassembler dans les terrains les plus voisins
des habitations ; à les séparer des végétaux
inutiles, pour que ce terrain leur appartînt tout entier ; à les
mettre à l’abri, des animaux sauvages, et des troupeaux, et même
de la rapacité des autres hommes. De même, dans
les pays où des plantes, des graines, des
fruits spontanément offerts par le sol, contribuoient, avec les
produits des troupeaux, à la nourriture de l’homme, on a dû observer
aussi comment ces végétaux se multiplioient ; et, dès-lors,
chercher à les rassembler dans les terrains les plus voisins
des habitations ; à les séparer des végétaux
inutiles, pour que ce terrain leur appartînt tout entier ; à les
mettre à l’abri, des animaux sauvages, et des troupeaux, et même
de la rapacité des autres hommes.
 Ces idées
ont dû naître encore, et même plutôt, dans les
pays plus féconds, où ces Ces idées
ont dû naître encore, et même plutôt, dans les
pays plus féconds, où ces
 C 3 C 3
(38 )
productions spontanées de
la terre suffisoient presque à la subsistance des hommes. Ils
commencèrent donc à se livrer à l’agriculture.
 Dans un pays fertile,
dans un climat heureux, le même espace de
terrain produit en grains, en fruits, en racines, de quoi nourrir beaucoup
plus d’hommes que s’il étoit employé en pâturages.
Ainsi, lorsque la nature du sol ne rendoit pas cette culture trop pénible,
lorsqu’on eut découvert le moyen d’y employer les mêmes
animaux qui servoient aux peuples pasteurs pour les voyages ou pour les
transports, lorsque les instrumens aratoires eurent acquis quelque
perfection, l’agriculture devint
la source de subsistance la plus abondante, l’occupation première
des peuples ; et le genre humain atteignit sa troisième époque. Dans un pays fertile,
dans un climat heureux, le même espace de
terrain produit en grains, en fruits, en racines, de quoi nourrir beaucoup
plus d’hommes que s’il étoit employé en pâturages.
Ainsi, lorsque la nature du sol ne rendoit pas cette culture trop pénible,
lorsqu’on eut découvert le moyen d’y employer les mêmes
animaux qui servoient aux peuples pasteurs pour les voyages ou pour les
transports, lorsque les instrumens aratoires eurent acquis quelque
perfection, l’agriculture devint
la source de subsistance la plus abondante, l’occupation première
des peuples ; et le genre humain atteignit sa troisième époque.
 Quelques peuples
sont restés, depuis un temps immémorial,
dans un des deux états que nous venons de parcourir. Non-seulement,
ils ne se sont pas élevés d’eux-mêmes à de
nouveaux progrès, mais les relations qu’ils ont eues avec les
peuples parvenus à Quelques peuples
sont restés, depuis un temps immémorial,
dans un des deux états que nous venons de parcourir. Non-seulement,
ils ne se sont pas élevés d’eux-mêmes à de
nouveaux progrès, mais les relations qu’ils ont eues avec les
peuples parvenus à
(39 )
un très-haut degré de civilisation,
le commerce qu’ils ont ouvert avec eux, n’y ont pu produire cette révolution.
Ces relations, ce commerce leur ont donné quelques connoissances,
quelqu’industrie, et sur-tout beaucoup de vices, mais n’ont pu les tirer
de cette espèce d’immobilité.
 Le climat, les habitudes, les douceurs attachées à cette
indépendance presqu’entière, qui ne peut se retrouver
que dans une société plus perfectionnée même
que les nôtres, l’attachement naturel de l’homme aux opinions
reçues dès l’enfance, et aux usages de leur pays, l’aversion
naturelle de l’ignorance pour toute espèce de nouveauté,
la paresse de corps, et sur-tout celle
d’esprit, qui l’emportoient sur la curiosité si foible encore,
l’empire que la superstition exerçoit déjà sur
ces premières sociétés, telles ont été les
principales causes de ce phénomène ; mais il faut y joindre
l’avidité, la cruauté, la corruption, les préjugés
des peuples policés. Ils se montroient à ces
nations, plus puissans, plus riches, plus instruits, plus actifs, mais
plus vicieux, et sur-tout moins heureux qu’elles. Elles ont Le climat, les habitudes, les douceurs attachées à cette
indépendance presqu’entière, qui ne peut se retrouver
que dans une société plus perfectionnée même
que les nôtres, l’attachement naturel de l’homme aux opinions
reçues dès l’enfance, et aux usages de leur pays, l’aversion
naturelle de l’ignorance pour toute espèce de nouveauté,
la paresse de corps, et sur-tout celle
d’esprit, qui l’emportoient sur la curiosité si foible encore,
l’empire que la superstition exerçoit déjà sur
ces premières sociétés, telles ont été les
principales causes de ce phénomène ; mais il faut y joindre
l’avidité, la cruauté, la corruption, les préjugés
des peuples policés. Ils se montroient à ces
nations, plus puissans, plus riches, plus instruits, plus actifs, mais
plus vicieux, et sur-tout moins heureux qu’elles. Elles ont
 C 4 C 4
(40 )
dû souvent être
moins frappées de la supériorité de ces peuples,
qu’effrayées de la multiplicité et de l’étendue
de leurs besoins, des tourmens de leur avarice, des éternelles
agitations de leurs passions toujours actives, toujours insatiables.
Quelques philosophes ont plaint ces nations ; d’autres les ont louées
: ils ont appelé sagesse et vertu, ce que les premiers appeloient
stupidité et paresse.
 La question élevée entr’eux se trouvera résolue
dans le cours de cet ouvrage. On y verra pourquoi les progrès
de l’esprit n’ont pas toujours été suivis du progrès
des sociétés vers le bonheur et la vertu,; comment le
mélange
des préjugés et des erreurs a pu altérer le bien
qui doit naître des lumières, mais qui dépend plus
encore de leur pureté que de leur étendue. Alors, on verra
que ce passage orageux et pénible d’une société grossière à l’état
de civilisation des peuples éclairés et libres, n’est point
une dégénération de l’espèce humaine, mais
une crise nécessaire dans sa marche graduelle vers son perfectionnement
absolu. On verra que ce n’est pas La question élevée entr’eux se trouvera résolue
dans le cours de cet ouvrage. On y verra pourquoi les progrès
de l’esprit n’ont pas toujours été suivis du progrès
des sociétés vers le bonheur et la vertu,; comment le
mélange
des préjugés et des erreurs a pu altérer le bien
qui doit naître des lumières, mais qui dépend plus
encore de leur pureté que de leur étendue. Alors, on verra
que ce passage orageux et pénible d’une société grossière à l’état
de civilisation des peuples éclairés et libres, n’est point
une dégénération de l’espèce humaine, mais
une crise nécessaire dans sa marche graduelle vers son perfectionnement
absolu. On verra que ce n’est pas
( 41 )
l’accroissement des lumières,
mais leur décadence, qui a produit les vices des peuples policés
; et qu’enfin, loin de jamais corrompre les hommes, elles
les ont adoucis, lorsqu’elles n’ont pu les corriger ou les changer.
|