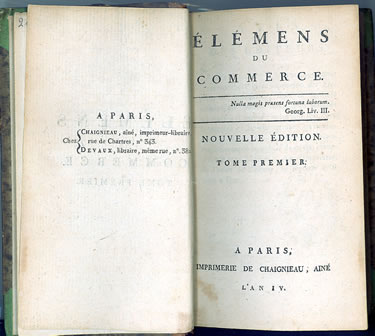
[402] CHAPITRE VIII.
Du Change.
Il n'y a que deux espèces de changes permis dans le Commerce.
Le premier est l'échange réel, qui se fait sous un certain droit d'une monnoie pour une autre monnoie chez les changeurs publics.
Le second change est une négociation par laquelle un négociant transporte à un autre les fonds qu'il a dans un pays étranger, à un prix dont ils conviennent.
Il faut distinguer deux objets dans cette négociation; le transport, et le prix de ce transport.
Le transport se fait par un contrat mercantile, appelé lettre-de-change, qui représente les fonds dont on fait la cession.
Le prix de ce transport est une compensation de valeur intrinsèque d'un pays à un autre; on l'appelle prix du change. [403] Il se divise en deux parties; l'une est son pair, l'autre son cours. L'exacte égalité de la quantité de monnoie d'un pays à celle d'un autre pays, est le pair du prix du change.
Lorsque les circonstances du Commerce éloignent cette compensation de son pair; les variations qui en résultent sont le cours du prix du change.
Le prix du change peut être défini en général une compensation momentanée des monnoies de deux pays, en raison des dettes réciproques.
Pour rendre ces définitions plus sensibles, il est à propos de considérer le change sous ses divers aspects et dans toutes ses parties.
Nous examinerons l'origine du change comme transport qu'un négociant fait à un autre des fonds qu'il a dans un pays étranger quelconque, sa nature, son objet, son effet: nous expliquerons l'origine du prix du change ou de la compensation [404] des monnoies, son essence, son pair, son cours, la propriété de ce cours, le Commerce qui en résulte.
Le premier Commerce entre les hommes se fit par échange: depuis, pour la commodité de ce Commerce, l'on eut recours à des signes qui représentassent les marchandises. L'or, l'argent et le cuivre devinrent la mesure des ventes et des achats; et leurs portions reçurent des formes telles que le législateur jugea à propos de les leur donner pour la sûreté publique. Ces portions revêtues d'un caractère authentique, qui certifioit du poids et du titre, furent appelées monnoies.
A mesure que le Commerce s'étendit, les dettes réciproques se multiplièrent; et le transport des métaux, représentant la marchandise devint pénible: on chercha des signes des métaux même.
Chaque pays achète des denrées ainsi qu'il en vend, et par conséquent se trouve tout-à-la-fois débiteur et créancier : [405] on en conclud [sic] que, pour payer les dettes réciproques, il suffiroit de se transporter mutuellement les créances réciproques d'un pays à un autre, et même à plusieurs qui seroient en correspondance entre eux. Il fut convenu que les métaux seroient représentés par un ordre que le créancier donneroit par écrit à son débiteur, d'en payer le prix au porteur de l'ordre.
La multiplicité des dettes réciproques est donc à l'origine du change, considéré comme le transport qu'un négociant fait à un autre des fonds qu'il a dans un pays étranger.
Puisqu'il suppose des dettes réciproques, sa nature consiste dans l'échange de ces dettes, ou des débiteurs. Si les dettes n'étoient pas réciproques, la négociation du change seroit impossible, et le paiement de la marchandise se feroit nécessairement par le transport des métaux.
L'objet du change est conséquemment [406]d'épargner le risque et les frais de ce transport.
Son effet est que les contrats qu'il emploie, ou les lettres-de-change, représentent tellement les métaux qu'il n'y a aucune différence quant à l'effet.
Un exemple mettra ces propositions dans un plus grand jour.
Supposons Pierre de Londres, débiteur de Paul de Paris pour des marchandises qu'il lui a demandées, et qu'en même temps Antoine de Paris en a acheté de Jacques de Londres pour une somme pareille; si les deux créanciers, Paul de Paris et Jacques de Londres échangent leurs débiteurs, tout transport de métaux est superflu. Pierre de Londres comptera à Jacques de la même ville la somme qu'il doit à Paul de Paris; et pour cette somme, Jacques lui transportera par un ordre écrit, celle qu'il a à Paris entre les mains d'Antoine. Pierre, propriétaire de cet ordre, le transportera à Paul, [407] son créancier à Paris, et Paul, en le représentant à Antoine, en recevra le paiement.
Si aucun négociant de Paris n'eût dû à Londres, Pierre eût été obligé de transporter ses métaux à Paris pour acquitter sa dette; ou si Jacques n'avoit vendu à Paris que pour la moitié de la somme que Pierre y devoit; la moitié de la dette de Pierre eût été acquittée par échange, et l'autre moitié par un transport d'espèces.
Il est donc évident que le change suppose des dettes réciproques; que, sans elles, il n'existeroit point, et qu'il consiste dans l'échange des débiteurs.
L'exemple proposé prouve également que l'objet du change est d'épargner le transport des métaux jusqu'à la concurrence des dettes réciproques. Supposons les dettes des deux villes de dix marcs d'argent, et évaluons le risque avec les frais du Commerce à un demi-marc; on voit que sans l'échange des débiteurs il en eût coûté dix marcs et demi [408] à chacun d'eux, au lieu de dix marcs.
L'effet du change est aussi parfaitement démontré dans cet exemple, puisque la lettre-de-change, tirée par Jacques de Londres sur Antoine de Paris, étoit tellement le signe des métaux, que Paul de Paris, à qui elle a été envoyée, a réellement reçu dix marcs d'argent en la représentant.
Cette partie du change que nous avons définie le transport qu'un négociant fait à un autre des fonds qu'il a dans un pays étranger, s'applique à la représentation des métaux; la seconde partie ou le prix du change s'applique à la chose représentée.
Lorsque l'or, l'argent et le cuivre furent introduits dans le Commerce, pour y être les signes des marchandises, et qu'ils furent convertis en monnoie d'un certain titre et d'un certain poids, les monnoies prirent leur dénomination du poids qu'on leur donna, c'est-à-dire qu'une [409] livre pesant d'argent fut appelée une livre.
Les besoins ou la mauvaise foi firent retrancher du poids de chaque pièce de monnoie, qui conserva cependant sa dénomination.
Ainsi il y a dans chaque pays une monnoie réelle et une monnoie idéale.
On a conservé les monnoies idéales dans les comptes pour la commodité: ce sont des noms collectifs qui comprennent sous eux un certain nombre de monnoies réelles.
Les altérations survenues dans les monnoies n'ont pas été les mêmes dans tous les pays: le rapport des poids n'est pas égal, non plus que celui du titre; la dénomination est souvent différente. Telle est l'origine de la comparaison qu'il faut faire de ces monnoies pour les échanger l'une contre l'autre, ou les compenser.
Le besoin plus ou moins grand que l'on a de cet échange, sa facilité ou sa difficulté, enfin sa convenance et ses frais ont une valeur dans le Commerce, et [410] cette valeur influe sur le prix de la compensation des monnoies.
Ainsi leur compensation ou le prix du change renferme deux rapports qu'il faut examiner.
Ce sont ces rapports qui font son essence; car si les monnoies de tous les pays étoient encore réelles, si elles étoient d'un même titre, d'un même poids; enfin si les convenances particulières n'étoient point évaluées dans le Commerce, il ne pourroit y avoir de différence entre les monnoies, et dès-lors il n'y auroit point de compensation à faire. Une lettre-de-change seroit simplement la représentation d'un certain poids d'or ou d'argent.
Une lettre-de-change sur Londres de 100 livres représenteroit 100 livres qui, dans cette hypothèse, seroient réelles et parfaitement égales.
De ces deux rapports, celui qui résulte de la combinaison des monnoies est le plus essentiel, et la base nécessaire de la compensation ou du prix du change.
Pour le trouver, ce rapport juste de la combinaison des deux monnoies, il faut connoître avec la plus grande précision le poids, le titre, la valeur idéale de chacune, et le rapport des poids dont on se sert dans l'un et l'autre pays pour peser les métaux.
L'argent monnoyé est supposé en Angleterre du même titre que l'argent mon-[412]noyé de France, c'est-à-dire à 11 deniers de fin, 2 grains de remède de loi.
La livre sterling est une monnoie idéale, ou un nom collectif, qui comprend sous lui plusieurs monnoies réelles, comme les écus ou crowns de 60 sous courans, les demi-crowns, les schelins de 12 sous, etc.
Les écus ou crowns pèsent chacun une once trois deniers treize grains: mais l'once de la livre de troy ne pèse que 480 grains. Ainsi le crown en pèse 565; et il vaut 5 sous, ou 60 deniers sterling.
En France nous avons deux sortes d'écus; l'écu de change ou de compte, toujours estimé 3 livres ou 60 sols tournois, valeurs également idéales.
La seconde espèce de nos écus est celle des pièces réelles d'argent, que nous appelons écus; ils sont, comme ceux d'Angleterre, au titre effectif de 10 deniers 22 grains de fin, ils sont à la taille de 16 trois cinquièmes au marc; le marc [413] de 8 onces, l'once de 576 grains. Ils passent pour la valeur de 60 sous; mais ils n'en valent intrinsèquement que 56 et demi le marc à 46 livres 18 sous.
Cette différence vient du droit de seigneuriage et des frais de brassage ou fabrication, évalués à 2 liv. 18 sous par marc.
Tout cela posé, pour connoître combien de parties d'un crown ou de 60 deniers sterling acquittera notre écu de la valeur intrinsèque de 56 sous 6 deniers, il faut comparer ensemble les poids et les valeurs : les titres étant égaux, il n'en résulteroit aucune différence; il est inutile de les comparer.
| 938 f. prix du marc de France | = | 8 onces de France. |
| )( once de France | = | 576 grains de poids |
| 565 grains de poids d'un crown | = | 60 d. sterl. |
| X | = | 56 et demi valeur intrinsèque de l'écu courant. |
|
Le rapport 29 den. et demi. |
||
[414] Le nombre trouvé de 29 d. et demi sterling est le rapport juste de la comparaison des deux monnoies, ou le pair du prix du change; c'est-à-dire que notre écu réel de la valeur intrinsèque de 56 sous 6 den., porté à Londres, y vaudra 29 den. et demi sterling; or notre écu de compte de 3 liv. ou 60 sous tournois représente l'écu réel, il s'ensuit que sa valeur est la même.
Si, conservant le titre, la France augmentoit sa monnoie du double; c'est-à-dire que le marc d'argent hors d'œuvre à 46 liv. 18 sous montât à 93 liv. 16 s., nos écus réels qui ont cours pour 3 liv. doubleroient de dénomination; ils prendroient la place des écus qui ont cours pour 6 liv., et ces derniers auroient cours pour douze. Mais leur valeur de poids et de titre n'ayant point augmenté, ils ne vaudroient que le même prix relativement à l'Angleterre. On substitueroit aux écus de 56 s. 6 d. actuels [415] d'autres écus qui auroient cours pour 3 liv. de 33 un cinquième au marc : ces écus, dont le poids seroit diminué de moitié, ne vaudroient à Londres que 14 d. trois quarts sterling; et l'écu de compte représentant toujours l'écu de 3 liv. réel, la parfaite égalité de la compensation, ou le pair du prix du change, seroit à 14 d. trois quarts sterling. Si, au contraire, l'espéce diminuoit de moitié; si le marc d'argent hors d'œuvre baissoit de 46 liv. 18 s. à 23 liv. 9 s. le marc, en conservant le titre, nos écus réels qui ont aujourd'hui cours pour 3 liv. ne seroient plus que des pièces de 30 s. de valeur numéraire; mais le poids et le titre n'ayant point changé, ces pièces de 30 s. vaudroient toujours à Londres 29 d. et demi sterling. Les écus qui ont aujourd'hui cours pour 6 liv. de la valeur intrinsèque de 113 s. et à la taille de 8 trois dixièmes au marc, ne seroient plus que des écus [416] de 3 liv. valeur numéraire, et de 56 s. 6 d. valeur intrinsèque: mais le poids de cet écu se trouvant doublé, ils seroient évalués à Londres à 59 d. sterling. C'est donc le nombre de grains pesant d'argent fin, contenus dans une pièce de monnoie qui forment évidemment sa valeur relative avec une autre monnoie; et les valeurs numéraires ne servent qu'à la dénomination de cette valeur relative. Ce rapport, qui indique la quantité précise qu'il faut de l'une pour égaler une quantité de l'autre, est appelé le pair du prix du change. Tant qu'il est la mesure de l'échange des monnoies, la compensation est d'une parfaite égalité.
Jusqu'à présent nous n'avons parlé du prix réel du change que sur la proportion des monnoies d'argent entre elles, parce que ce métal étant d'un plus grand usage dans la circulation, c'est lui qu'on a choisi pour faire l'évaluation de l'échange [417] des monnoies. On se tromperoit cependant si l'on jugeoit toujours sur ce pied-là du bénéfice que fait une nation dans son change avec les étrangers. On sait qu'outre la proportion générale et uniforme dans tous les pays entre les degrés de bonté de l'or et de l'argent, il y en a une particulière dans chaque état entre la valeur de ces métaux. Elle est réglée sur la quantité qui circule de l'une et de l'autre et sur la proportion que gardent les peuples voisins. Car si une nation s'en éloignoit trop, elle perdroit bientôt la portion de métal dont il y auroit du profit à faire l'extraction.
L'Angleterre nous fournit l'exemple du second pair réel du change. On vient de voir que le pair réel de nos écus de la valeur intrinsèque de 56 s. 6 d. est 29 d. et demi sterl.; ainsi les huit valent 236 d. st.
La guinée pèse 2 gros 12 grains, et contient 143 grains d'or pur, qui valent 21 schelins ou 252 d. sterling.
[418] Notre louis d'or contient 139 grains pesant d'or pur, qui valent par conséquent 244 d. cent trente-six cent quarante-troisième sterling. Ainsi les huit écus, qui, en argent, valent 236 sterl. en valent 244 d. cent trente-six cent quarante-troisièmes, lorsqu'ils sont représentés par l'or. La différence est de 8 d. cent trente-six cent quarante-troisièmes sterling; et il est évident qu'étant répartie sur les huit écus représentés par le louis d'or, le change de chacun est à 30 d. cent soixante-dix sept deux cent quatre-vingt sixièmes sterling, au lieu de 29 d. et demi.
Le change étant à 30 d. avec l'Angleterre, nous pourrions lui payer une balance considérable, quoique le pair du prix de l'argent indiquât un bénéfice.
Cette différence vient de ce qu'en France on donne 139 grains d'or pur pour 2020 grains d'argent fin; ce qui établit la proportion entre ces deux métaux, comme [419] de 1 à 14 quatre-vingt-sept cent trente-neuvièmes. En Angleterre, on donne 143 grains d'or pour 21 schelins, qui pèsent chacun 104 grains d'argent fin, et en tout 2184 grains; ainsi la proportion y est comme de 1 à 15 trente-neuf cent quarante-troisièmes environ.
Dès-lors, si nous avons à payer en Angleterre en espèces, il y a de l'avantage à porter des matières d'or; et il y en aura pour l'Angleterre à payer en France avec les monnoies d'argent. Car la guinée ne vaut dans nos monnoies que 22 livres 14 s. 7 d., et les schelins qu'elle représente pesant 2373 grains y seront payés 24 liv. 2 s. 10 den.
Diverses circonstances éloignent le prix du change de celui du pair réel; et comme ces accidens se varient à l'infini, l'altération de l'égalité parcourt sans cesse différens degrés. Cette altération est appelée le cours du prix de change.
Les causes de l'altération du pair du [420] prix du change sont l'altération du crédit public, et l'abondance ou la rareté des créances d'un pays sur un autre.
Une variation dans les monnoies est un exemple de l'altération que le discrédit public jette dans le pair du prix du change : quoique l'instant même du changement dans la monnoie donne un nouveau pair réel du prix du change, la confiance publique disparoissant à cause de l'incertitude de la propriété, et les espèces ne circulant pas, il est nécessaire que le signe qui le représente soit au-dessous de sa valeur.
La seconde cause de l'altération du pair dans le prix du change est l'abondance ou la rareté des créances d'un pays sur un autre; et cette abondance ou cette rareté ont elles-mêmes deux sources ordinaires.
L'une est le besoin qui oblige le corps politique d'un état à faire passer de grandes sommes d'argent dans l'étranger, comme la circonstance d'une guerre.
[421] L'autre source est dans la proportion des dettes courantes réciproques entre les particuliers.
Les particuliers de deux nations peuvent contracter entre eux deux sortes de dettes réciproques.
L'inégalité des ventes réciproques formera une premiere espèce de dettes.
Si l'une des deux nations a chez elle beaucoup d'argent à un intérêt plus foible que l'on n'en paie dans l'autre nation, les particuliers riches de la première achèterons les papiers publics de la seconde qui paie les intérêts de l'argent plus cher : le produit de ces effets, qui doit lui être payé tous les ans, forme une seconde espèce de dette. Elle ne peut être que regardée que comme une spéculation: dans ce cas et dans plusieurs autres l'argent est marchandise. Ainsi ces deux dettes appartiennent à ce [422] que l'on appelle proprement la balance du Commerce; et elles occasionneront une rareté ou une abondance de créances d'un pays pour un autre.
Lorsque deux nations veulent faire la balance de leur Commerce, c'est-à-dire payer leurs dettes réciproques, elles ont recours à l'échange des débiteurs: mais si les dettes réciproques ne sont pas égales, l'échange des débiteurs ne paiera qu'une partie de ces dettes. Le surplus, qui est ce que l'on appelle la balance du Commerce, devra être payé en espèces.
L'objet du change est d'épargner le transport des métaux, parce qu'il est coûteux et risquable: par conséquent chaque particulier, avant de s'y déterminer, cherchera des créances sur le pays où il doit. Ces créances seront chères à mesure qu'elles seront plus difficiles à acquérir: par conséquent, pour avoir la préférence, on les paiera au-dessus de leur valeur. Si elles sont communes, on les paiera au-dessous.
[423] Supposons que les marchands de Paris doivent aux fabricans de Rouen vingt mille livres, et que ceux-ci doivent dix mille livres à des banquiers de Paris; pour solder ces dettes, il faudra faire l'échange des dix mille livres de créances réciproques, et faire voiturer dix mille livres de Paris à Rouen.
Supposons encore les frais et les risques de ce transport à cinq livres par mille livres; chaque marchand de Paris tâchera de s'épargner cette dépense; il cherchera à acheter une créance de mille livres sur Rouen. Mais comme ces créances sont rares et recherchées, il donnera volontiers mille quatre livres pour en avoir la préférence, et il s'épargnera une livre de frais par mille livres. Ainsi la rareté des lettres-de-change sur Rouen baissera le prix de ce change au-dessous de son pair de quatre livres par mille livres.
Il est bon d'observer que la hausse ou la baisse du prix des changes en général [424] s'entendent toujours relativement aux pays étrangers. Les changes sont bas quand ces pays paient moins de valeur réelle en acquittant une lettre-de-change qu'elle n'en a coûté à l'acquéreur: les changes sont hauts quand ces pays paient plus de valeur réelle en acquittant une lettre-de-change qu'elle n'en a coûté à l'acquéreur.
Je parle du prix des changes en général; car nous verrons dans un moment que la hausse ou la baisse d'un change particulier ne doivent pas s'entendre de même, à cause de la différence qui se trouve dans l'énoncé du prix du change particulier des divers pays. Mais, pour ne point confondre les objets, il suffit d'établir ici que lorsqu'on dit en général les changes sont bas, on veut faire entendre qu'ils sont désavantageux: lorsqu'on dit en général les changes sont hauts, on veut faire entendre qu'ils sont avantageux.
Pour reprendre l'exemple proposé ci-[425]dessus, on vient de voir qu'à Paris la rareté des créances sur Rouen fait payer aux acquéreurs des lettres-de-change mille quatre livres, pour recevoir mille livres à Rouen.
Le contraire arrivera dans cette dernière ville : Paris lui devant beaucoup, les créances sur Paris y seront abondantes. Les fabricans de Rouen qui doivent à Paris donneront ordre au banquier de tirer sur eux, parce qu'ils savant qu'avec mille livres sur Rouen, ils acquitteront 1004 livres à Paris; ou, si on leur propose des créances sur Paris, ils les achèteront sous le même bénéfice que les créances sur Rouen sont à Paris; ce qui haussera ce change, au profit de Rouen, de 4 livres par mille livres : ainsi, d'une lettre-de-change de mille livres, ils ne donneront que neuf cent quatre-vingt-seize livres. Lorsque les dettes réciproques seront acquittées, il faudra que Paris fasse voiturer à Rouen l'excédent en espèces. Mais en [426] attendant, il est clair, que dans le paiement des dettes réciproques, Rouen aura acquitté mille livre de dettes avec neuf cent quatre-vingt-seize livres, et que Paris n'a pu acquitter mille livres qu'avec mille quatre livres.
Si le change subsiste long-temps sur ce pied entre ces deux villes, il sera évident que Paris doit à Rouen, plus que Rouen ne doit à Paris : d'où l'on peut conclure que la propriété du cours du prix du change, est d'indiquer de quel côté penche la balance du Commerce.
L'on a déjà vu que le pair du prix du change est la compensation des monnoies de deux pays; cette compensation s'éloigne souvent de son égalité, ainsi elle est momentanée; son cours indique de quel côté penche la balance du Commerce: ainsi le prix du change est une compensation momentanée des monnoies de deux pays en raison des dettes réciproques.
La nature des accidens du Commerce [427] qui altèrent l'égalité de la compensation des monnoies, ou le pair du prix du pair du change, étant de varier sans cesse, le cours du prix du change doit varier avec ces accidens.
L'instabilité de ce cours a deux effets : l'un, de rendre indécise d'un jour à l'autre la quantité de monnoie qu'un état donnera en compensation de telle quantité de monnoie d'un autre état; le second effet de l'instabilité de ce cours est un commerce d'argent par le moyen des représentations d'espèces ou des lettres-de-change.
De ce que la quantité de monnoie qu'un état donnera en compensation d'une telle quantité de monnoie d'un autre état est indécise d'une semaine à l'autre, il s'ensuit qu'entre ces deux états l'un propose un prix certain, et l'autre un prix incertain, parce que tout rapport suppose une unité qui soit la mesure commune des deux termes de ce rapport, et qui serve à l'évaluer.
[428] Supposons que Londres donne aujourd'hui 30 d. sterling pour un écu à Paris; il est certain que Paris donnera toujours un écu à Londres, quel que soit le cours du prix du change les jours suivans. Mais il est incertain que Londres continue de donner 30 d. sterling pour la valeur d'un écu; c'est ce qu'en termes de change on appelle donner le certain ou l'incertain.
Si les quantités étoient certaines de part et d'autre, il n'y auroit point de variation dans le pair du prix du change, et par conséquent point de cours.
Cette différence, qui ne tombe que sur l'énoncé du prix du change, s'est introduite dans chaque pays, selon la diversité des monnoies de compte; elle fixe une quantité dont l'évaluation servira de second terme pour évaluer une autre quantité de même espèce que la premiere.
Si, par exemple, un écu vaut 30 den. sterling, combien cent écus vaudront-ils de ces deniers que l'on réduit ensuite en [429] livres? Ainsi entre deux places, l'une doit toujours proposer une quantité certaine de sa monnoie pour une quantité incertaine que lui donnera l'autre.
Mais, tandis qu'une place donne le certain à une autre, elle donne quelquefois l'incertain à une troisième. Paris donne à Londres le certain, c'est-à-dire un écu, pour avoir de 29 et demi à 33 den. sterling; mais Paris reçoit de Cadix une piastre pour une quantité incertaine de sous, depuis 75 à 80 par piastre, suivant que les accidens du Commerce le déterminent.
Cette différence en introduit une dans l'acception des mots de hausse et de baisse du change, lorsqu'ils sont appliqués à un change particulier.
Lorsqu'un pays donne le certain à un autre, comme Paris avec Londres, le change haut indique l'avantage, et le change bas le désavantage. Le pair de notre écu étant avec Londres 29 den. et [430] demi sterling, il est clair que, si le change monte à 32 d., nous gagnons deux deniers et demi; s'il baisse à 28 d., nous perdons un denier et demi sterling par écu. Au contraire, lorsqu'un pays reçoit d'un autre le certain pour une quantité incertaine qu'il donne, comme Paris avec Cadix, le change haut indique le désavantage, et le change bas l'avantage. Le pair de la piastre de huit réaux supposé à 77 sous pour avoir à Cadix une piastre de change, il est évident que nous perdons un sou par piastre; si ce change baisse à 76 sous tournois, nous gagnons un sou par piastre.
Le second effet de l'instabilité du cours dans le prix du change, est un commerce d'argent par le moyen des représentations d'espèces ou des lettres-de-change.
Le négociant ou le banquier veille sans cesse aux changemens qui surviennent dans le cours du prix du change, entre les diverses places qui ont une correspon-[431]dance mutuelle. Il compare ces changemens entre eux, et ce qui en résulte; il en recherche les causes, pour en prévoir les suites; le fruit de cet examen est de faire passer ses créances sur une ville, dans celle qui les paiera le plus cher: mais cet objet seul ne remplit pas les vues du négociant qui fait ce commerce. Avant de vendre ses créances dans un endroit, il doit prévoir le profit ou la perte qu'il y aura à retirer ses fonds de cet endroit: si le cours du prix du change n'y est pas avantageux avec le lieu de sa résidence, il cherchera des routes écartées, mais plus lucratives; et ce ne sera qu'après différens circuits que la rentrée de son argent terminera l'opération. La science de ce commerce consiste donc à saisir toutes les inégalités favorables que présentent les prix du change entre deux villes, et entre ces deux villes et les autres. Car si cinq places de commerce s'éloignent entre elles du pair du prix du [432] change dans la même proportion, il n'y aura aucune opération lucrative à faire entre elles: l'intérêt de l'argent et les frais de commission tourneroient en pure perte. Cette égalité réciproque entre le cours du prix du change de plusieurs places s'appelle le pair politique.
Si nous convenons de cette parité,
|
a |
= |
b c |
| c | = | a |
il est constant que a, b, et c étant des quantités égales, il n'y aura aucun bénéfice à les échanger l'une contre l'autre; ce qui répond au pair réel du prix du change. Supposons à présent
|
a |
= |
b c |
| c | = | a + d |
la parité sera rompue; il faudra échanger b contre c, qui lui donnera a + d : or nous avons supposé a = b, ainsi le [433] profit de cet échange sera d. Cette différence répond aux inégalités du cours du prix du change entre deux ou plusieurs places. La parité sera rétablie, si ces quantités augmentent entre elles également :
|
a + d |
= |
b + d c + d |
| c + d | = | a + d |
c + d = a + d;cette parité répond au pair politique du prix du change, ou à l'égalité de son cours entre plusieurs places.
La parité sera de nouveau altérée, si
|
a + d |
= |
b + d c + d |
| c + d | = | a + d + f, |
dans ce cas l'échange devra se faire comme on vient de le voir; et le profit de b + d sera f.
Si tout le reste égal, a + d - f = c + d, et que l'on échange ces deux quantités l'une contre l'autre, il est clair que [434] le propriétaire de c + d recevra de moins la quantité f : ainsi pour éviter cette perte, il échangera c + d contre b + d qui est égal à la quantité a + d.
Il est évident que l'opération du change consiste à échanger des quantités de matière fine l'une contre l'autre.
Que celui qui est forcé d'échanger une quantité contre une autre quantité moindre que la sienne, en cherche une troisième qui soit égale à la sienne, et qui soit réputée égale à celle qu'il est forcé d'échanger, afin de s'épargner une perte.
Que celui qui fait le Commerce du change s'occupe à échanger de moindres quantités contre de plus grandes: par conséquent son profit est l'excédent de la quantité que divers échanges lui ont procuré dans son pays, sur la quantité qu'il a fournie pour le premier.
Ce Commerce n'est lucratif, qu'autant qu'il rend un bénéfice plus fort que ne l'eût été l'intérêt de l'argent placé pen-[435]dant le même temps dans le pays de celui qui fait l'opération: d'où il s'ensuit que le peuple chez lequel l'argent est à plus bas prix, aura la supériorité dans ce Commerce sur celui qui paie l'intérêt de l'argent plus cher; que si ce peuple qui paie les intérêts de l'argent à plus bas prix en a abondamment, il nuira beaucoup à l'autre dans la concurrence de ce Commerce; et que ce dernier aura peine à faire entrer chez lui l'argent étranger par cette voie.
Ce Commerce n'est pas celui de tous qui augmente le plus la masse d'argent dans un état; mais il est le plus savant et le plus lié avec les opérations politiques du gouvernement.
Il résulte des variations continuelles dans le prix du change, à l'occasion de l'inégalité des dettes réciproques entre divers pays, comme le change lui-même doit sa naissance à la multiplicité des dettes réciproques.
[436] De tout ce que nous avons dit sur le change on peut tirer ces principes généraux.
1°. L'on connoîtra si la balance générale du Commerce d'un état pendant un certain espace de tems lui a été avantageuse, par le cours mitoyen de ses changes avec tous les autres états pendant le même espace de tems.
2°. Tout excédent des dettes réciproques de deux nations, ou toute balance de Commerce doit être payée en argent, ou par des créances sur une troisième nation; ce qui est toujours une perte, puisque l'argent qui lui seroit revenu est transporté ailleurs.
3°. Le peuple redevable d'une balance perd, dans l'échange qui se fait des débiteurs, une partie du bénéfice qu'il avoit pu faire sur ses ventes, outre l'argent qu'il est obligé de transporter pour l'excédent des dettes réciproques: et le peuple créancier gagne, outre cet argent, une [437] partie de sa dette réciproque dans l'échange qui se fait des débiteurs. Ainsi le peuple débiteur de la balance a vendu ses denrées moins cher, et a acheté plus cher les denrées du peuple créancier: d'où il résulte que chez l'un l'industrie est découragée, tandis qu'elle est animée chez l'autre.
4°. Dans le cas où une nation doit à une autre des sommes capables d'opérer une baisse considérable sur le change, il est plus avantageux de transporter l'argent en nature, que d'augmenter sa perte en la faisant ressentir au Commerce. Cette opération est d'autant plus essentielle, que, dans une pareille circonstance, la totalité des changes d'une nation est en souffrance.
Fin du Tome premier.