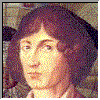
NICOLAS COPERNIC(1).
QUELQUE innombrables que soient les fléaux qui d'ordinaire amènent la décadence des royaumes, des principautés et des républiques, les quatre suivants sont, à mon sens, les plus redoutables : la discorde, la mortalité, la stérilité de la terre et la détérioration de la monnaie. Pour les trois premiers, l'évidence fait que personne n'en ignore. Mais, pour le quatrième, qui concerne la monnaie, excepté quelques hommes d'un très-grand sens, peu de gens s'en occupent. Pourquoi? parce que ce n'est pas d'un seul coup, mais petit à petit, par une action en quelque sorte latente, qu'il ruine l'Etat.
L'or ou l'argent marqués d'une empreinte, constituent la monnaie servant à déterminer le prix des choses qui s'achètent et qui se vendent, selon les lois établies par l'Etat ou le prince. La monnaie est donc en quelque sorte une mesure commune d'estimation des valeurs; mais cette mesure doit toujours être fixe et conforme à la règle établie. Autrement, il y aurait, de toute nécessité, désordre dans l'Etat: acheteurs et vendeurs seraient à tout moment trompés, comme si l'aune, le boisseau ou le poids ne conservaient point une quotité certaine. Or cette mesure réside, [51] selon moi, dans l'estimation de la monnaie. Bien que, cette estimation ait pour base la bonté de la matière, il faut cependant la discerner de la valeur. La monnaie, en effet, peut-être estimée plus que la matière dont elle est faite, et vice versa.
L'établissement de la monnaie a la nécessité pour cause. Bien qu'en pesant seulement, l'or et l'argent on aurait pu pratiquer les échanges, ces métaux, du consentement unanime des hommes, étant considérés partout comme choses de prix, cependant il y aurait de nombreux inconvénients à être obligé de porter toujours des poids avec soi, et, tout le monde n'étant pas apte à connaître du premier coup d'il la pureté de l'or et de l'argent, on convint partout de faire marquer par l'autorité la monnaie d'une empreinte destinée à exprimer ce que chaque pièce contient d'or et d'argent et à servir de garantie a la foi publique.
On a coutume de mêler du cuivre à la monnaie et surtout à la monnaie d'argent. J'y suppose deux causes: d'abord pour qu'elle soit moins exposée au retrait et à la refonte, ce qui arriverait si elle était d'argent pur. Secondement, pour que la pièce d'argent divisée en parties menues et même en très-petites monnaies conserve, grâce à l'alliage, c'est-à-dire au cuivre qu'on y mêle, une grandeur convenable. A ces deux causes on peut en ajouter une troisième: comme la monnaie s'use en circulant constamment, on l'a soutenue par un alliage de cuivre, qui la fait durer plus longtemps.
La monnaie est estimée à son taux véritable, quand elle contient un tant soit peut moins d'or ou d'argent que la quantité de ces métaux qu'elle peut payer, juste autant [53] qu'il en faut déduire pour acquitter les frais de monnoyage. L'empreinte de garantie ajoute quelque valeur a la matière elle-même. La monnaie perd surtout de sa valeur quand on l'a trop multipliée, lorsque, par exemple, une si grande quantité d'argent a été transformée en monnaie, que les hommes en arrivent à rechercher l'argent en lingot plus que le numéraire. La monnaie perd toute sa dignité, quand elle ne peut plus acheter autant d'argent qu'elle en contient et qu'il y a profit à la refondre. L'unique remède alors, c'est de ne plus frapper de monnaie jusqu'à ce qu'elle ait repris son équilibre et qu'elle ait reconquis une valeur plus élevée que celle de l'argent.
La valeur de la monnaie se déprécie pour diverses causes, soit par l'altération du titre, alors que le même poids contient un alliage de cuivre qui dépasse la mesure voulue; soit parce que le poids fait défaut, bien que l'alliage ait été introduit au degré convenable; soit, ce qui est le pire, parce que les deux vices se rencontrent à la fois. La valeur de la monnaie se perd d'elle-même par suite d'un long service qui use le métal et en diminue la quotité et cette raison suffit pour faire mettre en circulation une monnaie nouvelle. On reconnaît cette nécessité à un signe infaillible, lorsque l'argent contenu dans la monnaie pèse notablement moins que l'argent destiné à être acquis. On comprend qu'il en ressort une détérioration de la monnaie.
Après avoir fourni ces données générales sur la monnaie, descendons à l'étude spéciale de la monnaie prussienne, et montrons comment elle s'est tellement avilie.
Elle circule sous le nom de marcs, de scotes (2), etc. Les mêmes dénominations désignent aussi des poids; le marc [55] (poids) est une demi-livre; le marc (monnaie) se compose de 60 sous: ce qui est généralement connu. Mais, pour que le même nom donné au numéraire et au poids ne devienne point une cause d'obscurité, partout où, dans la suite, nous parlerons de marc, il faudra entendre par là le numéraire; quand nous dirons la livre, il s'agira du poids de 2 marcs, et la demi-livre signifiera le marc pesant.
Nous trouvons dans les anciennes délibérations et dans les documents écrits que
sous le gouvernement de Conrad de Jungingen, peu de temps avant la bataille de
Taneberg (l'an 1410), la demi-livre, c'est-à-dire le marc d'argent pur, valait 2 marcs
prussiens et 8 scotes ; à trois parties d'argent pur on ajoutait alors un quart de
cuivre, et dans la demi-livre de cet alliage on taillait 112 sous. En y ajoutant un
tiers, c'est-à-dire 37 sous ![]() , on obtient un total de 149 sous
, on obtient un total de 149 sous ![]() (pesant
(pesant ![]() de la
livre, c'est-à-dire 32 scotes d'argent) qui contiennent évidemment ¾ d'argent pur,
ou l'équivalent d'une demi-livre de métal fin. Nous avons déjà dit que la demi-livre
d'argent pur valait 140 sous. Les 9 sous
de la
livre, c'est-à-dire 32 scotes d'argent) qui contiennent évidemment ¾ d'argent pur,
ou l'équivalent d'une demi-livre de métal fin. Nous avons déjà dit que la demi-livre
d'argent pur valait 140 sous. Les 9 sous ![]() d'excédant répondent à la valeur
d'estime ajoutée par le monnoyage. De cette manière le prix nominal se maintenait
dans un rapport convenable avec la valeur intrinsèque.
d'excédant répondent à la valeur
d'estime ajoutée par le monnoyage. De cette manière le prix nominal se maintenait
dans un rapport convenable avec la valeur intrinsèque.
Telles étaient les pièces de monnaie du temps des (grands maîtres) Henri, Ulric et Conrad; on les rencontre encore de temps à autre dans les trésors. Plus tard, après la défaite subie par la Prusse et la guerre dont nous avons parlé, le déclin de l'Etat, sous le rapport de la monnaie, devint de jour en jour plus apparent. En effet, les sous frappés sous Henri, bien que semblables d'aspect à ceux qui les avaient précédés, [57] ne contiennent plus que 3/5 d argent. Ce faiblage s'accrut jusqu'à ce que l'on en vînt, en sens inverse, à mêler à trois parties de cuivre un quart d'argent; dès lors on se serait expliqué plus justement, si on avait parlé de monnaie de cuivre, non de monnaie d'argent. Le poids de 112 sous répondait cependant toujours à la demi-livre. S'il ne convient nullement d'introduire une nouvelle et bonne monnaie, lorsque l'ancienne est mauvaise et continue de circuler, on commet une erreur bien plus grave encore en introduisant, à côté d'une monnaie ancienne, une monnaie nouvelle plus faible; celle-ci ne se borne pas à déprécier l'ancienne, elle la chasse pour ainsi dire de vive force. Sous l'administration de Michel Rusdorff (1439), on voulut parer au mal et ramener la monnaie à son ancien état de pureté. On frappa de nouveaux sous, ceux qu'aujourd'hui nous nommons gros. Mais comme on ne crut pas pouvoir, à cause de la perte qui en serait résultée, retirer les anciennes pièces, qui ne les valaient pas, par une faute plus grande, on les laissa subsister avec les nouvelles; deux sous anciens s'échangeaient contre un nouveau, et un double marc existait sur le marché, à savoir le marc des nouveaux sous, et le marc des anciens. Le nouveau marc des premiers ou le bon, l'ancien marc des seconds ou le faible se divisaient l'un et l'autre en 60 sous. Quant aux oboles, elles gardaient leur valeur habituelle, de sorte que pour 1 sou ancien on en donnait 6 seulement, tandis qu'il en fallait 12 pour un nouveau. Dans le principe, le sou se composait de 12 oboles, il est facile de le comprendre, car comme nous disons vulgairement mandel pour le nombre 15, de même dans beaucoup de provinces germaniques le [59] mot shilling s'applique au nombre 12. Celle dénomination des nouveaux sous se conserva jusqu'à nos jours.
Je dirai plus loin comment ils se changèrent en gros.
Huit marcs des nouveaux sous (à soixante sous par marc) contenaient une livre d'argent pur, comme il est facile de le calculer. Ils se composent, en effet, par moitié de cuivre et d'argent. Les huit marcs (à raison de soixante sous par marc) pèsent près de deux livres. Quant aux sous anciens, bien qu'ils représentent le même poids, ils valent moitié moins. Comme ils ne contenaient qu'un quart d'argent, il en fallait à la livre d'argent fin 16 marcs , qui pesaient quatre fois plus. Par suite des changements survenus dans le pays, quand les villes acquirent le droit de frapper monnaie (3), et qu'elles usèrent de ce nouveau privilége [sic] le numéraire augmenta en quantité, mais non en valeur: on commença à ne mêler à quatre parties de cuivre qu'un cinquième d'argent dans les sous anciens, de manière que la livre d'argent représentât 20 marcs. Les sous nouveaux valaient ainsi plus du double des anciens; on en fit donc des scotes, dont on compta 24 pour un marc faible : la monnaie perdit au marc un cinquième de sa valeur intrinsèque. Mais, comme par la suite les nouveaux sous, devenus des scotes, disparaissaient de plus en plus, parce qu'ils étaient reçus dans toute l'étendue de la Marche, on leur attribua la valeur de gros, c'est-à-dire de trois sous, bien qu'ils n'eussent point une valeur supérieure à celle de quinze deniers de la monnaie ayant cours, et dont la quantité trop grande déprimait le prix. Cette décision fut arrêtée par une erreur des plus lourdes, tout à fait indigne d'une pareille assemblée des citoyens les notables, comme si la [61] Prusse avait été hors d'état de se passer de cette monnaie.
Il y avait donc entre les gros et les sous une différence du cinquième ou du sixième en moins de la valeur établie, et par cette fausse et inique évaluation les gros dépréciaient les sous. Les sous expiaient ainsi le tort qu'ils avaient primitivement fait aux gros, en les forçant de se changer en scotes.
Malheur à toi, terre de Prusse , qui payes de ta ruine, hélas! les fautes d'un mauvais gouvernement ! Bien que la valeur d'estime et la valeur réelle de la monnaie disparussent ainsi simultanément, on continua de fabriquer de la monnaie. Mais comme les frais de monnayage n'étaient pas couverts, la monnaie empira sans cesse, dégradant successivement le numéraire existant , de façon que la valeur des sous et celle des gros finirent par se niveler proportionnellement, et qu'on finit par payer une livre d'argent pur au prix de 211 marcs faibles.
Tels devaient être les résultats de la détérioration de la monnaie, dont on ne songeait pas à relever le titre. L'habitude invétérée de refondre et de falsifier la monnaie de toute manière n'a pas encore cessé de nos jours. Ce que deviendra cette monnaie et ce qu'elle est déjà devenue, on a honte et douleur à le dire : elle est tellement avilie aujourd'hui, que 30 marcs contiennent à peine une livre d'argent. Qu'arrivera-t-il si l'on n'y porte remède? La Prusse, dépouillée d'or et d'argent, n'aura plus qu'une monnaie de cuivre, ce qui arrêtera les importations étrangères et ruinera tout commerce. En effet, quel est le marchand étranger qui voudra échanger des marchandises contre de la monnaie de cuivre? et qui de nous pourra dans les autres [63] pays acheter les marchandises du dehors avec cette même monnaie ? Cependant ceux que cela regarde envisagent froidement cette immense ruine de la Prusse, et leur indolence laisse dépérir et ruiner entièrement cette patrie si douce pour tous, cette patrie qui, après la piété envers Dieu, leur impose les devoirs les plus sacrés, et à laquelle ils devraient le sacrifice même de la vie. Tandis que la monnaie prussienne, et par suite la patrie, sont travaillées de tels vices, les orfévres [sic] seuls et ceux qui se connaissent en métaux précieux profitent de nos malheurs. Ils trient dans la monnaie les pièces anciennes, qu'ils refondent afin de vendre l'argent, recevant toujours du vulgaire inexpérimenté, plus d'argent avec la même somme de monnaie. Alors que les anciens sous ont presque entièrement disparu , ils choisissent ce qu'il y a de meilleur parmi le reste, ne laissant dans la circulation que la masse des plus mauvaises monnaies. De là vient cette plainte incessante qui retentit de tout côté, que l'or et l'argent, le blé et les provisions domestiques et le travail des artisans , tout ce dont les hommes font usage d'ordinaire, augmente de prix. Notre négligence nous empêche de voir que la cherté de toutes choses provient de l'avilissement du numéraire. En effet, leur prix augmente et diminue proportionnellement à la monnaie, surtout celui des métaux précieux, que nous estimons, non en airain ou en cuivre, mais en or et en argent; car l'or et l'argent constituent la base de la monnaie, et ils en déterminent la valeur.
Peut-être dira-t-on : «La monnaie faible est plus commode pour les usages de la vie, elle vient en aide à la pauvreté, elle met le blé à plus bas prix, et elle facilite l'acquisition des autres choses nécessaires à la vie ; la bonne [65] monnaie, au contraire, rend tout plus cher; elle surcharge les fermiers, les censitaires, et tous ceux qui ont à faire des payements. » Cet avis sera du goût de ceux qu'on priverait d'un gain notable en leur enlevant la faculté de battre monnaie. Peut-être aussi ce sera l'avis des marchands et des artisans qui n'éprouvent aucune perte à vendre leurs marchandises et leurs produits n'importe le prix de l'or; car plus la monnaie est avilie et plus ils en demandent pour leur marchandise et leur travail. Mais en portant la vue sur l'utilité commune, ils ne sauraient nier que la bonne monnaie est avantageuse, non-seulement à l'Etat, mais encore à eux-mêmes, et aux hommes de toute condition, tandis que la monnaie défectueuse est grandement nuisible. Un grand nombre de preuves le rend évident, et l'expérience, ce guide le plus sûr, en démontre pleinement la vérité. En effet, nous voyons fleurir les pays qui possèdent une bonne monnaie, tandis que ceux qui n'en ont que de mauvaise, tombent en décadence et dépérissent. La Prusse, elle aussi, était florissante, alors qu'un marc pruthénien valait 2 florins hongrois (ducats), et que, comme nous l'avons dit plus haut, 2 marcs pruthéniens et 8 scotes s'échangeaient contre une demi-livre, c'est-à-dire contre un marc d'argent pur. Mais l'avilissement croissant de notre monnaie amène l'abaissement de la patrie, qui, atteinte par ce fléau et par d'autres calamités, touche presque aux portes du tombeau .
Il est incontestable que les pays qui font usage de bonne monnaie brillent par les arts, possèdent les meilleurs ouvriers, et ont de tout en abondance. Tout au contraire, dans les Etats qui se servent d'une monnaie dégradée, [67] règnent la lâcheté, la paresse et l'indolence ; on y néglige les arts et la culture de l'esprit, et l'on y subit la plus triste indigence. On se rappelle encore du temps où le blé et les vivres étaient à meilleur marché en Prusse, alors qu'on faisait usage de bonne monnaie. Maintenant que le numéraire est avili, nous pouvons constater chaque jour combien a renchéri tout ce qui sert à la nourriture et à l'entretien des hommes. Il en résulte clairement que la monnaie faible nourrit bien plus la paresse qu'elle ne soulage la pauvreté. Une monnaie de meilleur aloi ne porterait même aucun préjudice à ceux qui acquittent un cens annuel pour leur domaine; en effet, ils vendraient aussi plus cher les fruits de la terre, le bétail et toute espèce de produits. L'échange fait qu'on donne et qu'on reçoit tour à tour, et la monnaie rétablit un équilibre proportionnel en opérant la compensation.
Si l'on vent enfin remédier aux malheurs de la Prusse en redressant la monnaie, il faut d'abord empêcher la confusion qui peut résulter de la diversité des ateliers monétaires. Elle empêche, en effet, l'égalité de valeur, et il est plus difficile de retenir dans la ligne du devoir plusieurs ateliers qu'un seul. On désignerait donc en tout deux places : l'une sur les terres soumises à la Majesté royale (4), l'autre sur les terres qui sont ait pouvoir du prince (5). Dans le premier atelier, on frapperait une monnaie qui, d'un côté, porterait les insignes royaux, de l'autre, ceux de la terre de Prusse. Dans le second, la monnaie porterait, d'un côté, les insignes royaux, et de l'autre, l'empreinte du prince ; car la condition première à maintenir, c'est que l'une et l'autre monnaie demeurent sous le contrôle du pouvoir royal, et [69] qu'elles aient cours et soient acceptées dans tout le royaume en vertu d'une prescription de Sa Majesté : ce qui ne serait pas d'une médiocre importance pour la conciliation des esprits et pour les transactions réciproques.
Il faudra que ces deux monnaies soient au même degré de fin, aient une même valeur réelle et une même valeur nominale (6), afin que, par des soins vigilants, l'Etat arrive à garder perpétuellement le règlement qu'il s'agit maintenant d'établir; il n'appartient point aux princes de tirer aucun profit de la monnaie qu'ils frapperont; ils ajouteront seulement autant d'alliage qu'il en faut pour que la différence entre la valeur réelle et la valeur nominale permette de couvrir les frais du monnayage, ce qui écartera le principal attrait de la refonte (7).
De même, afin de ne plus retomber dans la confusion dont souffre notre temps, confusion qu'a fait naître la circulation simultanée de la nouvelle monnaie et de l'ancienne, il faudra, lors de l'émission de la monnaie nouvelle, démonétiser l'ancienne et en interdire entièrement l'emploi, en l'admettant à s'échanger dans les ateliers de monnayage, dans la juste proposition de la valeur intrinsèque. Autrement ce serait peine perdue que de vouloir rétablir la bonne monnaie; la confusion qui s'ensuivrait serait peut-être pire que l'état actuel. L'ancienne monnaie anéantirait encore tout l'avantage de la nouvelle. La cxistence des deux monnaies empêcherait l'égalité du poids voulu, et l'on verrait renaître tous les inconvénients que nous avons signalés plus haut. On dira qu'on pourrait y remédier, en déclarant que les vieilles pièces maintenues dans la circulation seraient d'autant moins estimées, en face de la nouvelle mon-[71]naie, qu'elles seraient d'une valeur moindre ou d'un moindre poids. Mais cette mesure causerait encore une grande erreur. La multiplicité, et la diversité, tant des gros et des sous que des deniers, est si grande maintenant, qu'il serait presque impossible de les estimer à leur juste valeur, et de distinguer entre ces pièces si variées. On arriverait à une confusion inextricable, qui augmenterait le travail, les ennuis et les autres incommodités du trafic journalier; il vaudra donc toujours mieux, lorsqu'on émettra une nouvelle monnaie, démonétiser entièrement l'ancienne. Chacun devra, sans murmurer, supporter une petite perte, une fois subie, si toutefois on peut appeler perte ce qui amène un profit considérable, une utilité plus constante, et un état plus prospère du pays.
Il est fort difficile, et peut-être impossible de relever à sa première valeur la monnaie prussienne, après une chute si profonde. Mais toute amélioration réalisée dans ce sens n'est pas de faible importance. Cependant, il semble que dans les circonstances actuelles on peut la fortifier de sorte que la livre d'argent revienne au moins à 20 marcs. Voici de quelle manière : les sous seraient frappés avec un alliage composé de trois livres de cuivre et d'une livre d'argent pur, moins une demi-once, ou autant qu'il en faudra déduire pour couvrir les frais de monnayage.
De cette masse on tirera 20 marcs, qui vaudront une livre, c'est-à-dire deux marcs d'argent. On peut frapper an même titre des scotes, on des gros et des oboles, à volonté.
[73] Comparaison de l'argent à l'or.
Nous avons dit que l'or et l'argent étaient la base sur laquelle repose la valeur de la monnaie. Ce que nous avons avancé touchant la monnaie d'argent peut également, en grande partie, s'appliquer à la monnaie d'or. Il nous reste à exposer le mode de l'échange mutuel de l'or et de l'argent. Afin de passer du genre à l'espèce et du simple au composé, il faut d'abord connaître le rapport du prix de l'or pur à celui de l'argent pur. On sait que la même proportion subsiste entre l'or et l'argent purs, qu'entre l'or et l'argent monnayés au même titre; comme aussi que la même proportion s'applique à l'or monnayé et à l'or en lingot qu'à l'argent monnayé et à l'argent en lingot, pourvu qu'ils aient même titre d'alliage et qu'ils représentent même poids. L'or le plus pur, qui se rencontre monnayé chez nous, c'est celui des ducats hongrois. Il y entre en effet le moins d'alliage, autant peut-être qu'il en a fallu pour couvrir les frais du monnayage. Aussi s'échangent-ils, d'ordinaire, avec raison contre le même poids d'or pur, la garantie de l'empreinte remplaçant ce qui leur manque en poids. Il s'ensuit qu'une proportion pareille existe à égalité de poids entre l'argent pur et l'or pur, et entre ce même argent et les ducats hongrois. Cent dix ducats, ayant le poids légal de 72 grains, font une livre. (J'entends toujours par livre le poids de deux marcs.) Nous trouvons ainsi chez toutes les nations qu'une livre d'or pur vaut communément douze livres d'argent pur. (8) Mais onze livres d'argent ont valu autrefois une livre d'or. C'est pourquoi on avait établi la [75] proportion en vertu de laquelle dix ducats hongrois d'or pesaient le onzième d'une livre. Si, sous ce même poids, on rencontrait encore aujourd'hui la même valeur, on arriverait à une conformité très-avantageuse des monnaies polonaise et pruthénienne, d'après le rapport que nous avons établi. En effet, une livre d'argent donnant environ 20 marcs, deux marcs représenteraient exactement un ducat, en place de 40 gros polonais. Mais depuis qu'il a été admis que douze en argent vaut un en or, le poids diffère du prix, de sorte que dix ducats (florins d'or hongrois) rachètent une livre d'argent, plus le onzième de la livre. Si donc de la livre d'argent, plus le onzième de cette livre, on fait 20 marcs, les monnaies polonaise et prussienne seront exactement conformes, gros pour gros, et les deux marcs pruthéniens vaudront le ducat hongrois. Le prix de chaque demi-livre d'argent sera d'environ huit marcs et de dix sous.
Cependant, si l'on s'inquiète peu de la dépréciation de la monnaie et de la ruine de la patrie, si l'on trouve trop difficile d'opérer ce petit changement et cette concordance du numéraire, et si l'on préfère que 13 gros polonais continuent à valoir un marc, que 2 marcs et 16 scotes représentent un ducat hongrois, une pareille réforme s'opérera aisément par le moyen que nous avons déjà indiqué, en taillant 24 marcs d'argent à la livre.
Il en était ainsi quand 12 marcs formaient le prix de chaque demi-livre d'argent, et s'échangeaient pour pareille somme contre les ducats hongrois. Cet exemple conduit à se former des idées nettes en cette matière, car les modes de constitution de la monnaie sont infinis, et l'on ne saurait les décrire tous. Mais le consentement commun pourra, [77] après mûre délibération, déterminer le choix qui semblera le plus avantageux à l'Etat. Quand une fois le numéraire sera réglé, sans erreur, sur le ducat hongrois, il sera facile d'estimer par comparaison les autres monnaies, selon la quantité d'or et d'argent qu'elles contiendront.
Ce que je viens de dire touchant la restauration de la monnaie, doit suffire pour faire comprendre comment la valeur du numéraire s'est dégradée, et comment on peut la lui rendre.
Epilogue sur le rétablissement de la monnaie.
Pour arriver à restaurer et à conserver une bonne monnaie, plusieurs choses sont à considérer :
1° Elle ne doit être modifiée qu'après mûre délibération des notables et en vertu de leur décision unanime.
2° Un seul lieu, si faire se peut, doit être choisi pour la fabrication de la monnaie, qui doit être frappée, non pas au nom d'une ville, mais au nom du pays, en portant pour empreinte les insignes de l'Etat. L'efficacité d'une pareille mesure rencontre une preuve décisive dans la monnaie polonaise, qui conserve ainsi son prix dans la vaste étendue du royaume.
3° Lors de l'émission d'une nouvelle monnaie, l'ancienne doit être démonétisée et supprimée.
4° Il faut garder pour règle inviolable et immuable de tailler 20 marcs seulement, et non davantage, dans une livre, en retranchant seulement la quantité nécessaire pour les frais du monnayage. De cette manière, la monnaie prussienne sera mise en rapport avec la monnaie [79] polonaise, de manière que 20 gros prussiens, aussi bien que 20 gros polonais, constitueront le marc pruthénien.
5° On évitera une trop grande multiplication de numéraire.
6° Toutes les subdivisions de la monnaie seront émises en même temps ; c'est-à-dire on frappera simultanément des scotes, des gros, des sous et des oboles.
Quant à la proportion à conserver, elle dépendra de ceux qui frapperont monnaie; ils décideront ce qu'ils doivent frapper de gros et de sous, ou encore de deniers d'argent, qui vaudront un ferton (9), ou un demi-marc, ou même le marc entier, pourvu qu'ils conservent la même proportion, et qu'ils demeurent fidèles à la règle une fois établie.
Il faut aussi tenir compte des oboles, dont la valeur est maintenant si faible, que le marc entier contient à peine autant d'argent qu'un gros.
Une dernière difficulté provient des contrats passés et des obligations consenties avant et après la refonte de la monnaie. Il importe de trouver un mode transitoire qui empêche les parties contractantes d'être trop lésées. On y a pourvu anciennement dans une circonstance pareille, ainsi que le montre le document ci-joint (10).