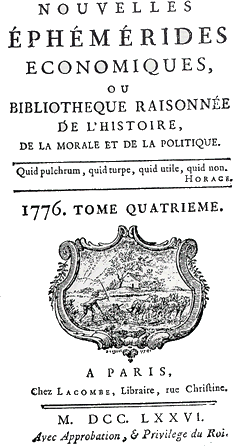 |
NOUVELLES
EPHEMERIDES ÉCONOMIQUES. SECONDE PARTIE. ANALYSES, N°. PREMIER.
AVANT-PROPOS. Vous venez, Monsieur, de publier, avec les plus grands éloges, un Livre Elémentaire, intitulé le |
||||
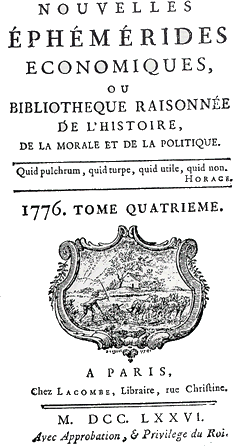 |
NOUVELLES
EPHEMERIDES ÉCONOMIQUES. SECONDE PARTIE. ANALYSES, N°. PREMIER.
AVANT-PROPOS. Vous venez, Monsieur, de publier, avec les plus grands éloges, un Livre Elémentaire, intitulé le |
||||
|
|110| Commerce & le Gouvernement,
considérés relativement l'un à l'autre. |
|111| dans le moment présent
un titre qu'il ne faut pas donner à ceux qui le refusent, mais
uniquement à ceux qui l'acceptent. En agir autrement, c'est s'exposer
à calomnier les uns & les autres, & par conséquent
à commettre une double injustice. |
|
|112| rendre ridicules ; nous nous
y sommes attendus. Quelle est la science ou, l'opinion, qui n'ait pas
produit de pareils effets ? |
|113|xistence des Antipodes n'ont-ils
pas excité de terribles fermentations? Les premiers Professeurs qui
voulurent nous apprendre à prononcer moins mal le latin, &
à comprendre un peu le grec, ne furent-ils pas les victimes de
leur zele ? |
|
|114| une source de ruine ou de prospérité
? c'est le temps qui le fera voir ; c'est la discution libre qui l'éclaircira
; c'est la prospérité qui le jugera. |
|115| Cette distinction, il la prouve
par son propre exemple, & nous pourrions la confirmer par celui de
plusieurs autres, notamment de ceux dont les écrits nous sont attribués
dans ce moment. |
|
|116|même, à ce sujet,
dans deux ouvrages publics), les torts imaginaires ou réels qu'on
nous impute. |
|117| l'autorité du Prince
& de ses Tribunaux, ni la religion, ses dogmes & sa discipline,
ni les bonnes moeurs & l'honnêteté publique, ni les personnes
de nos concitoyens. Il y auroit peut-être plus de justice aux critiques
& à ceux qui s'en rendent les échos de consulter les
ouvrages des vrais économistes, de les comparer avec les autres,
de dire ensuite, voici la ressemblance . . . . . mais . . . . . voici
la différence. |
|
|118| |
|119| de précision & de
clarté que je le desirerois. En attendant, je me borne à quelques
traits de votre Livre Elémentaire. |
|
|120|mencé par faire cette
langue, & qu'on nous faisoit un crime d'avoir voulu fixer à
la Science Economique un langage particulier. N°. PREMIER.
|
|121|res. Les denrées sont
les productions qui servent à notre subsistance & à celle
des animaux que nous élevons. Les matieres premieres sont des productions
qui peuvent prendre différentes formes, & par-là devenir
propres à divers usages. F |
|
|122|rez forcé vous-même
de l'abandonner. Il en est enfin une troisieme qu'on trouvera pour le
moins très problématique. |
|123| “La premiere s'appelle
donc, pour abréger, les subsistances ; la seconde s'appelle, dans
l'état brut, ou de simplicité primitive, les matieres premieres
(page 11). Fij |
|
|124| Mais quand vous dites, les matieres
premieres “sont des productions qui peuvent prendre différentes
formes, & par-là devenir propres à divers usages”,
permettez moi d'observer que ce n'est pas là précisément
le caractere qui les distingue des subsistances. |
|125| précisément encore
dans la même classe; car ce ne sont exactement, comme vous savez,
que des matieres travaillées & mises en oeuvre. Cependant, je
tiens pour assuré qu'en aucune langue on ne les appelle des meubles. Fiij |
|
|126|vin, &c. sont des effets
mobiliers. |
|127|N°. II.
Biv |
|
|128|“Dans cette régie (continuez-vous)
nous voyons un homme qui fournit le fonds, c'est le colon ; un entrepreneur
qui se charge de veiller à la culture, c'est le fermier; &
des valets ou journaliers qui font les ouvrages.” |
|129|aussi, même plus souvent
en cultivateur, du verbe françois cultiver, je cultive,
parcequ'en effet on traduit en latin ces mots, cultiver, je cultive,
cultivateur, par ceux ci, colere, colo, colonus
; d'où le françois, colon tire évidemment son
origine. Fv |
|
|130| Quand le propriétaire foncier
veut recevoir en nature sa portion des fruits récoltés, c'est
un partage, entre deux co-propriétaires, de ces productions, qui
se fait suivant leurs conventions & leurs droits respectifs. La suite aux plus prochains Recueils.
|